
Le vieil-anglais (VA) est une langue dite SOV (les langues germaniques, tel l´allemand contemporain, sont des langues ayant une typologie OV/VO), avec la valeur de paramètre tête finale : quelle que soit la projection, un complément précède la tête de cette projection (sauf pour COMP qui a son complément à droite).

C´est aussi une langue V2 : le verbe fini monte en seconde position de la phrase, alors que le topique, situé à sa gauche, peut être n´importe quel élément de la phrase. Dans un premier temps, nous suivons Pintzuk (1991), qui analyse la phrase VA comme une structure IP-V2 : le verbe fini monte de V, sa position de base, à I (ou T), qui est la seconde position. C´est le cas dans la phrase simple (où TP est l´équivalent de IP).
| Seuerus | se | casere | onfeng | micelne | dæl | Breotene... |
| Severus-NOM | le-NOM | empereur-NOM | reçut-IND.PRET | grande-ACC | partie-ACC | Bretagne-GEN... |
L´empereur Severus reçut une grande partie de la Bretagne... (cobede,BedeHead : 1.6.14.6)
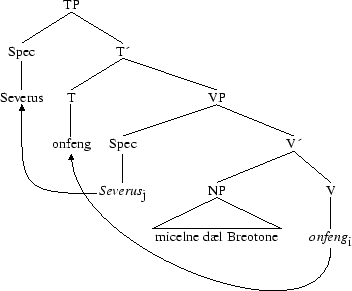
Dans la phrase complexe dite enchâssée, nous avons toujours une structure IP-V2. Mais pour Pintzuk, il y a deux variantes : une structure INFL-médiane (7.a) et une structure INFL-finale (7.b).
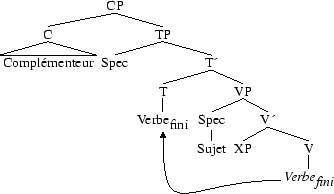
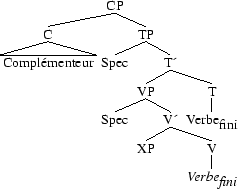
| ... | þe | god | worhte | þurh | hine... |
| ... | lequel | Dieu | œuvra | à travers | lui... |
Structure INFL-médiane :
[C þe [TP godj [T worhte [VP tj þurh hine [V ti]]]]]
Structure INFL-finale :
[C þe [TP godj [VP tj þurh hine [V ti [T weorhte [PP þurh hine]]]]]]
Enfin, dans un petit nombre de phrases (les questions, les phrases dont le topique est un élément négatif ou les adverbes de temps þa ou þonne), la structure est CP-V2 : le verbe fini monte de V à T à C (Spec,CP étant réalisé).
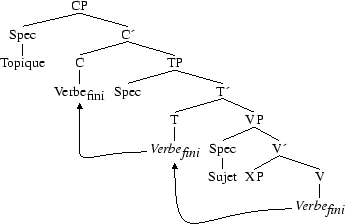
| Ða | gewænde | seo | wydewe | ham... |
| Alors | retourna-PRET | la-NOM | veuve-NOM | en direction de la maison... |
La veuve retourna alors chez elle... (coaelive,ÆLS_[Eugenia] :144.277)
Avant d´aborder l´analyse des perfecto-présents vieil-anglais, donnons les structures de certains types de verbes. Ces structures vont nous être utiles au cours de notre travail. Toutes suivent le schéma suivant : Sujet + Verbe fini + Verbe à l´infinitif.
En anglais contemporain, nous trouvons deux types de verbes : des verbes lexicaux et des verbes opérateurs. Parmi ces types de verbes, certains sont des verbes de contrôle, d´autres des verbes de montée, d´autres des verbes causatifs, ou encore des verbes dont le complément sera un TP.
Une structure de contrôle est une structure dans laquelle la proposition infinitive comporte un sujet PRO qui est contrôlé par son antécédent :
They want to stay.
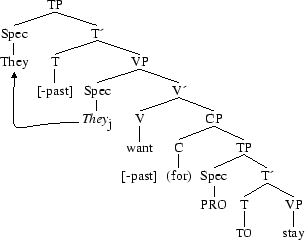
Le complément du verbe fini est ici un CP.
Dans l´exemple (14.a), le complément du verbe fini est un TP.
They heard John cry
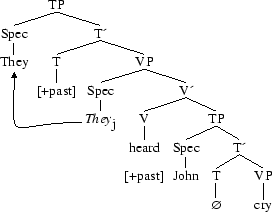
Les verbes causatifs, quant à eux, sont des verbes opérateurs : ils font partie de l´événement, mais ils ne sont pas l´événement ; ils introduisent une notion de cause sur l´événement. Ce sont des verbes comme make, have ou cause en anglais contemporain.
He made him cry.
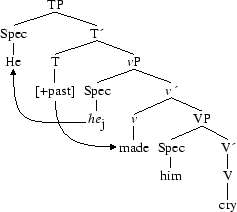
Nous avons enfin ce que l´on appelle des structures de montée. En anglais contemporain, un verbe de montée ne possède pas d´argument externe (c´est-à-dire de sujet) et il n´assigne pas de cas à son complément (le plus généralement une proposition infinitive). Ce sont des verbes lexicaux comme seem et appear en anglais contemporain. Parmi ces verbes de montée, nous trouvons aussi les verbes modaux. En anglais contemporain, nous pensons que les modaux sont générés sous T.
It seems that he understands her.
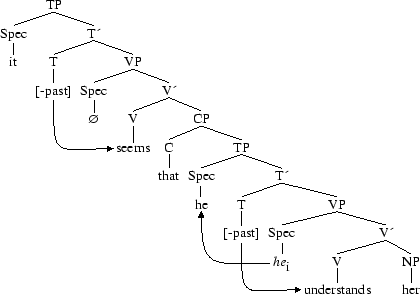
He seems to understand her.
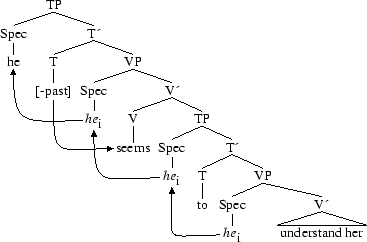
He can understand her.
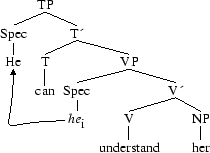
Nous invitons le lecteur à garder ces structures en tête car nous allons y revenir au fil de notre analyse des perfecto-présents (notamment les structures causatives et les structures de montée).
En vieil-anglais, il existe deux classes majeures de verbes : les verbes forts et les verbes faibles (note: ➳). Les perfecto-présents représentent une classe particulière (à cette classe nous ajoutons le verbe anomal WILLAN).
Les perfecto-présents sont des verbes qui ont la forme d´un parfait mais la valeur d´un présent (par exemple `I have got´ en anglais contemporain). Quant au verbe WILLAN, c´est un verbe athématique (c´est-à-dire sans thème (note: ➳)) en *-mi : la première personne du singulier du présent de l´indicatif était *-mi en indo-européen et en germanique (bio-m en VA `je suis´).
Les verbes que nous traitons sont donc les suivants (nous suivons la classification de Mossé (1945) : 118-21, des classes 1 à 6 (note: ➳)) :
Classe 1 : WITAN `savoir´, AGAN (note: ➳) `avoir, posséder´.
Classe 2 : *DUGAN `exister, être utile´. (note: ➳)
Classe 3 : UNNAN `accorder´, CUNNAN `pouvoir, savoir´, ÐURFAN `avoir besoin, être nécessaire´, DURRAN `oser´.
Classe 4 : MUNAN `se souvenir´, *SCULAN `être obligé, devoir´.
Classe 6 : *MOTAN `être autorisé, pouvoir´.
Non classé : MAGAN `être capable´. (note: ➳)
Verbe anomal : WILLAN `vouloir´.
Parmi ces verbes se trouvent les verbes modaux que nous connaissons en anglais contemporain. Dans la littérature concernant la diachronie, il est généralement admis que les verbes modaux tels que nous les connaissons sont « apparus » à la période moyen-anglaise (avant cette période, ils étaient de simples verbes lexicaux identiques aux autres, par exemple voir Allen (1975) ou Roberts (1993)). D´un point de vue syntaxique, nous nous opposons à cette assertion car, selon nous, les changements et les évolutions au sein d´une langue sont progressifs. Ainsi, l´hypothèse qui va sous-tendre notre analyse est que, dès la période vieil-anglaise, une position syntaxique particulière existe pour cette classe de verbes. Cette position que nous leur attribuons est différente de celle des autres verbes (les verbes forts et les verbes faibles qui sont générés sous la tête de VP). Notre analyse va nous amener à montrer qu´ils sont générés sous une position que nous nommons vModal. Nous tenons bien sûr compte, tout au long de notre travail, des relations, complexes, qui peuvent exister entre les notions de temps, de mode et de modalité. Pour ce faire, nous étudions l´évolution de ces verbes à travers différents textes issus de différentes périodes : Beowulf (cobeowulf dans les exemples) qui date du VIIe environ (≃ 680), Ecclesiastical History (cobede) de Bede le Vénérable qui date du IXe -Xe siècles (890) et Apollonius of Tyre (coapollo) qui date du XIe siècle (1050).
Nous venons de mentionner que le VA est une langue SOV, avec V2. Que le VA soit une langue CP-V2 ou IP-V2 ne change pas le fait qu´il existe des têtes fonctionnelles : C, T, sûrement Neg et v (la tête de transitivité) en plus de la tête lexicale V. L´analyse à venir nous permet d´y ajouter un autre petit v (notre hypothèse, un petit vModal, mais qui reste néanmoins dans le domaine de vP).
Nous montrons l´existence de ces têtes à partir d´exemples tirés du corpus VA. L´exemple qui suit,
| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |
| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |
et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au don de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)
illustre la structure (11), et montre l´existence de la tête C. Quant à l´exemple,
| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |
| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |
Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)
illustre la structure (6.b) et montre l´existence de la tête fonctionnelle T et de la tête lexicale V.
A ces deux exemples, nous en ajoutons d´autres, afin de mettre en valeur notre propos :
| & | he | openlice | sæde | þæt | he | his | bebodum | hyrsumian | ne | wolde. |
| & | il-NOM | ouvertement | dit-PRET | que | il-NOM | ses | ordres-DAT | obéir | NEG | voulait-PRET. |
et il dit ouvertement qu´il ne voulait pas obéir à ses ordres. (cobede,Bede_1 :7.36.12. 292 ; 890)
| þonne | sceal | he | hine | eaðmodlice | ahabban | from | onsægdnesse | þæs | halgan | gerynes... |
| alors | doit-IND.PRES | il-NOM | lui-ACC | respectueusement | retenir | de | sacrifice | le-GEN | saint-GEN | sacrement-GEN... |
il doit alors respectueusement s´abstenir de sacrifier le saint sacrement... (cobede, Bede_1 :16.86.16.784)
| Nolde | eorla | hleo | ænige | þinga | þone cwealmcuman | cwicne | forlætan. |
| NEG+voulait-PRET | guerriers-GEN | protecteur-NOM | aucune-INSTR | choses-GEN | invités meutriers-ACC | rapide-ACC | abandonner. |
Pour rien au monde le protecteur des guerriers ne voulut laisser partir les inviters meutriers vivants. (cobeowul,26.791. 678 ; 680)
| Ne | meahte | ic | æt | hilde | mid | Hruntinge | wiht | gewyrcan. |
| NEG | pouvait-PRET | je-NOM | jusqu´à | combat-DAT | avec | Hrunting-DAT | quelque chose-ACC | faire. |
Avec Hrunting je n´aurais rien pu faire dans le combat. (cobeowul,51.1659.1375)
Les exemples (22) et (25.a) (=(19)) montrent l´existence de la tête fonctionnelle C, car nous avons affaire à des structures CP-V2,
| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |
| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |
et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)
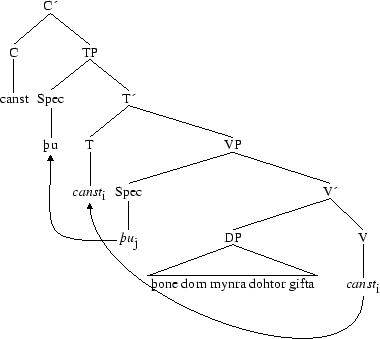
En effet, cet exemple illustre une structure CP-V2, avec mouvement du verbe fini de V à T, puis de T à C. D´après l´analyse de Pintzuk (1991), chapitre 3, le moyen de savoir si nous avons affaire à une structure CP-V2 ou IP-V2 est de voir la position du clitique sujet : si celui-ci est placé avant le verbe fini, c´est une structure IP-V2 ; si le clitique sujet est placé après le verbe fini (comme dans notre exemple), c´est une structure CP-V2 (note: ➳). L´ordre des constituants de ce genre de phrases (les questions directes, les phrases commençant par un constituant négatif ou par les adverbes de temps þa et þonne) est dérivé du mouvement du verbe fini de T à C (Pintzuk (1991) : 133).
L´exemple (26.a) (=(20)) illustre l´existence des têtes fonctionnelles T et de la tête lexicale V. Cet exemple est une structure IP-V2.
| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |
| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |
Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)
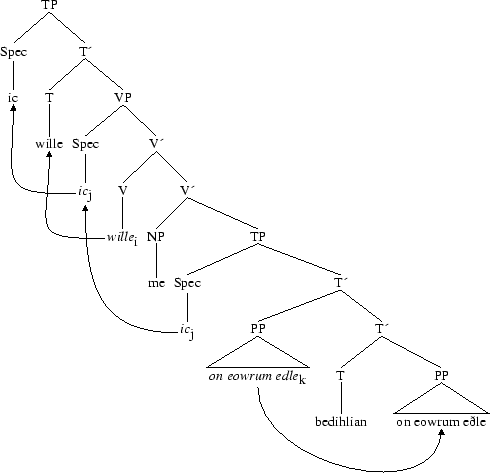
Nous n´entrons pas, pour le moment, dans les détails de cette structure enchâssée. Nous y revenons un peu plus loin dans notre travail.
On suppose généralement que le VA est une langue asymétrique : V2 pour les phrases matrices, mais pas pour les phrases enchâssées, puisque la position C est remplie par un complémenteur lexical. L´analyse de Pintzuk montre que la structure de la phrase VA est IP-V2, tant dans les phrases matrices que dans les phrases enchâssées (sauf pour un petit nombre restreint de phrases que nous venons de mentionner). C´est en analysant la distribution des particules, la distribution des pronoms et des adverbes monosyllabiques, ainsi que la fréquence relativement basse du phénomène syntaxique qu´est le Verb (Projection) Raising, qu´elle a pu montrer l´existence de structures INFL-médianes pour les phrases enchâssées du VA, avec la montée du verbe fini de V à T (note: ➳). Pour les phrases enchâssées (comme nous l´avons déjà mentionné), il y coexistence entre deux structures : les structures INFL-medianes et les structures INFL-finales. Dans les structures INFL-médianes, le verbe fini monte sous T, qui est en position V2 ; dans les structures INFL-finales, le verbe fini monte aussi sous T, mais c´est l´ordre au sein de TP qui est différent : la tête de TP est en position finale.
Les exemples (23) et (24) montrent l´existence d´une tête fonctionnelle Neg, sans que cela nous éclaire encore sur sa position syntaxique.
L´existence de ces têtes fonctionnelles nous permet d´introduire le cadre théorique dans lequel nous conduisons notre analyse : le programme minimaliste de Chomsky. Chomsky définit les têtes C et T comme appartenant aux catégories fonctionnelles principales (Core Functional Categories) de la phrase. C exprime la force et le mode, il peut ne pas être sélectionné (sélection sémantique) ; C sélectionne T et possède un trait EPP (c´est-à-dire une position Spec). Quant à la tête T, elle doit toujours être sélectionnée (sémantiquement), soit par C, auquel cas elle possède un ensemble de traits ϕ (traits de personne, genre, nombre), soit par V, et T est alors défectif. T possède un trait EPP et il sélectionne V.
La structure d´une phrase est alors (CP)-TP-VP, structure que nous appliquons au VA dans les exemples qui vont suivre.
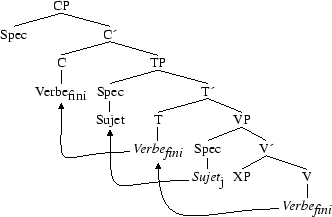
Cette structure s´applique aux exemples suivants :
| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |
| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |
et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au don de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)
[CP [C canst [TP [Spec ðu [T cansti [VP [V cansti þone dom mynra dohtor gifta ?]]]]]]]
| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |
| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |
Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)
[CP Forðam [C gif [TP hit [VP [V gewurðan [T mæg, [TP [Spec ic [T wille [VP [V willei [TP me bedihlian on eowrum eðle.]]]]]]]]]]]]
| Ne | meahte | ic | æt | hilde | mid | Hruntinge | wiht | gewyrcan. |
| NEG | pouvait-PRET | je-NOM | jusqu´à | combat-DAT | avec | Hrunting-DAT | quelque chose-ACC | faire. |
Avec Hrunting je n´aurais rien pu faire dans le combat. (cobeowul,51.1659.1375)
[CP [C Ne meahte [TP ic [T meahtei [VP [V meahtei [TP æt hilde mid Hruntinge wiht gewyrcan.]]]]]]]
A ce stade, nous n´irons pas plus loin concernant la position de base des perfecto-présents.
Les exemples (21), (23) et (24) donnent des formes présentes et prétérites des perfecto-présents, sans que nous puissions affirmer si ces formes sont indicatives ou subjonctives. En effet, le VA possédait deux modes, et à chacun de ces modes correspondaient des flexions verbales. Les formes des exemples (19), (20) et (22) sont au mode indicatif. Si le mode est indiqué via les flexions verbales, cela impliquerait qu´il existe une tête fonctionnelle pour ces deux modes (réalis et irréalis). Nous supposons que T accueille le mode [-irréel]. Mais nous allons revenir sur ce point plus loin dans notre travail, une fois définie la position correspondant aux perfecto-présents.
Précédemment, nous avons mentionné que les perfecto-présents formaient une classe de verbes à part entière, différents des verbes forts et des verbes faibles. En quoi sont-ils différents ? Tout d´abord, ils sont tous défectifs, (à l´exception de WILLAN), c´est-à-dire qu´ils ne possèdent pas un système de conjugaison complet (voir Annexe A). Ensuite, il existe une alternance vocalique entre la forme infinitive et le présent de l´indicatif qui n´apparaît pas pour les verbes forts et les verbes faibles. (note: ➳)
Enfin, les perfecto-présents sont les seuls à posséder une terminaison spécifique pour le pluriel du présent (toutes les personnes) : -on (witon, agon, cunnon, sculon, ...), alors que les verbes lexicaux ont : -að (nimað `ils/elles prennent´, demað `ils/elles décident´, habbað `ils/elles ont´, ...). Ils ont aussi la spécificité d´avoir des suffixes en dentale – -t(e), -d(e) and -ð(e) – pour le singulier du prétérit (moste, mihte, dorste, ...), comme les verbes faibles (les perfecto-présents sont construits en partie sur les verbes forts et en partie sur les verbes faibles (note: ➳)). Ces différences morphologiques vont nous être utiles lors de notre analyse. S´ils ont une morphologie particulière, ce peut être le point de départ de notre analyse pour leur allouer une position syntaxique.
Dans les exemples (19) à (24), nous avons pu situer les têtes C, T et V. Nous avons laissé sciemment de côté la position de la tête fonctionnelle Neg, et bien sûr celle des verbes perfecto-présents.
Pénétrons maintenant dans le vif du sujet : quelle position occupent les verbes perfecto-présents ?
Nous proposons qu´aux perfecto-présents correspondent deux têtes : V, pour les perfecto-présents qui sont employés commes des verbes lexicaux ; un petit v modal (plus précisément vModal) pour les perfecto-présents suivi d´un verbe à l´infinitif.
Lorsque le perfecto-présent est employé suivi d´un objet, il est donc généré sous un V lexical, puis fusionne à v, et réagit comme les verbes forts et les verbes faibles (c´est la structure (31)). Lorsque le perfecto-présent est suivi d´un verbe à l´infinitif, il est considéré comme un verbe semi-lexical (il n´y a pas encore grammaticalisation totale), et, de fait, il n´est plus généré sous V, mais sous vModal (c´est la structure (32)). Pourquoi postuler un vModal ? Dans tout notre corpus, ces perfecto-présents sont soit déontiques, soit épistémiques (nous y revenons plus longuement dans la Section 2.8.2). Nous avons donc les deux structures verbales suivantes, (31) lorsque le perfecto-présent est lexical, et (32) lorsqu´il est semi-lexical :
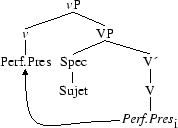
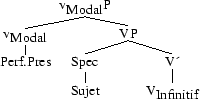
Dans les exemples qui vont suivre, le perfecto-présent est employé seul :
| No | hie | fæder | cunnon, | ... |
| Même pas | ils-NOM | père-ACC | connaissent-IND.PRES, | ... |
Ils ne lui connaissent pas de père, ... (cobeowul,42.1355.1119 ; 680)
| Ac | sio | ðeod | þone | cræft | þæs | fiscaþes | ne | cuðe, | ... |
| Mais | le-NOM | peuple-NOM | le-ACC | métier-ACC | la-GEN | pêche-GEN | NEG | connaissait-PRET, | ... |
Mais le peuple ne connaissait pas l´art de la pêche, ... (cobede,Bede_4 :17.304.10.3076 ; 890)
| ic | secge | ðe | to soðan | þone | forlidenan | man | ic | wille. |
| je-NOM | dis-IND.PRES | lui-NOM | précisément | le-ACC | naufragé-ACC | homme-ACC | je-NOM | veux-PRES |
Je te le dis en vérité, c´est le naufragé que je veux (pour époux). (coapollo,ApT :20.15. 427)
Reprenons l´exemple (33) (maintenant (36.a)) et donnons-en la structure, où le perfecto-présent CUNNAN est généré sous V, fusionne avec v, puis avec T :
| No | hie | fæder | cunnon, | ... |
| Même pas | ils-NOM | père-ACC | connaissent-IND.PRES, | ... |
Ils ne lui connaissent pas de père, ... (cobeowul,42.1355.1119 ; 680)
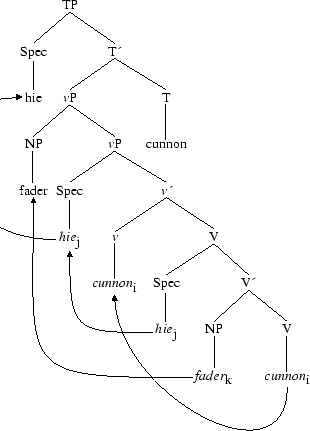
Dans la majorité des cas, le perfecto-présent est suivi d´un verbe à l´infinitif (un verbe fort ou faible, ou bien un autre perfecto-présent (noté en italique)) :
| Nu | ic | eower | sceal | frumcyn | witan, | ... |
| Maintenant | je-NOM | vous-ACC | dois-IND.PRES | ancêtres-ACC | connaître, | ... |
Maintenant, je dois connaître vos ancêtres, ... (cobeowul,10.251.203 ; 680)
| Ic | to | sæ | wille | wið | wrað | werod | wearde | healdan. |
| Je-NOM | vers | lac-DAT | PRES | contre | en colère-ACC | hôtes-ACC | gardien-ACC | protéger. |
Je vais retourner vers la mer pour (vous) protéger des hôtes hostiles. (cobeowul,12.318.257)
| Wille | ic | asecgan | sunu | Healfdenes, | mærum | þeodne, | min | ærende, | aldre | þinum, | gif | he | us | geunnan | wile | þæt | we | hine | swa | godne | gretan | moton. |
| PRES | je-NOM | dire | fils-DAT | Healfdene-GEN, | célèbre-DAT | roi-DAT, | mon-ACC | message-ACC, | parent-DAT | ton-DAT, | si | il-NOM | nous-DAT | accorder | veut-PRES | que | nous-NOM | lui-ACC | ainsi | bonté-ACC | saluer | devons-IND.PRES. |
J´aimerais délivrer mon message au fils du roi Healfdene, le grand prince, si, dans sa bonté, il nous accorde que nous le lui adressions. (cobeowul,13.344.285)
| ac | wit | on | niht | sculon | secge | ofersittan, | ... |
| mais | nous deux-NOM | dans | nuit-ACC | devons-IND.PRES | épée-ACC | renoncer, | ... |
mais nous devons renoncer à utiliser notre épée pendant la nuit, ... (cobeowul,22.681. 575)
| ... | þæt | he | wið | ælfylcum | eþelstolas | healdan | cuðe, | ða | wæs | Hygelac | dead. |
| ... | que | il-NOM | contre | ennemis-DAT | ville royale-ACC | administrer | put-PRET, | depuis que | était-IND.PRET | Hygelac-NOM | mort-NOM. |
... qu´il put administrer la ville royale contre les ennemis depuis la mort de Hygelac. (cobeowul,73.2367.1931)
| he | scolde | eaðmodlice | for | heo | þingian, | þæt | heo | ne | þorfte | in | swa | frecne | siðfæt | & | in | swa | gewinfulne | & | in | swa | uncuðe | elþeodignesse | faran. |
| il-NOM | dut-PRET | humblement | pour | elle-ACC | demander, | pour que | elle-NOM | NEG | eut besoin-PRET | dans | si | dangereux-ACC | voyage-ACC | & | dans | si | dur-ACC | & | dans | si | incertain-ACC | pélerinage-ACC | partir. |
il dut humblement intercéder en sa faveur pour qu´elle n´eut besoin de s´engager dans un dangereux voyage & un pélerinage si dur et incertain. (cobede,Bede_1 :13.56. 6.521 ; 890)
| Ic | gehyhte | & | wende, | þæt | wit | nu | hraðe | scoldon | ætgædre | in | ece | liif | gongan. |
| Je-NOM | espérais-IND.PRET | & | croyais-IND.PRET, | que | tous deux-NOM | maintenant | rapidement | devaient-IND.PRET | ensemble | dans | éternelle-ACC | vie-ACC | aller. |
J´esperais que nous aurions pu accéder ensemble à la vie éternelle. (cobede,Bede_3 :19.244.7.2499)
| ...þæt | he | swa | in | toweardnesse | ecelice | ricsian | mid | Criste | moste. |
| ...que | il-NOM | ainsi | pour | le temps à venir | éternellement | régner | avec | Christ-DAT | pouvait-PRET. |
... qu´il pouvait ainsi régner éternellement avec le Christ. (cobede,Bede_3 :21.248.21. 2544)
| ... | ond | hy | ealle | þa | bliðe | mode | lustlice | healdon | woldon. |
| ... | et | ils-NOM | tous-NOM | cela-ACC | joyeux-INSTR | cœur-INSTR | avec entrain | protéger | voulaient-IND.PRET. |
... et tous l´observèrent-ils volontiers d´un cœur joyeux. (cobede, Bede_4 :5.276.32.2812)
| Gif | hit | nænge | þinga | to dæge | beon | mægge. |
| Si | cela-NOM | aucune-INSTR | choses-GEN | aujourd´hui-DAT | être | puisse-SUBJ.PRES. |
Si aujourd´hui cela ne peut se produire avec aucune de ces choses. (cobede,Bede_4 : 12.290.20.2932)
| ... | þæt | nænig | ðara | onweardra | his | heortan | degolnessa | him | helan | dorste... |
| ... | que | aucun-NOM | les-GEN | opposants-GEN | son | cœur-GEN | secret-ACC | lui-DAT | dissimuler | osait-PRET... |
... qu´aucun des opposants n´osait lui dissimuler le secret de son cœur... (cobede,Bede_4 :28.362.27.3643)
| and | gif | ðu | þæt | ne | dest, | þu | scealt | oncnawan | þone | gesettan | dom. |
| et | si | tu-NOM | cela-ACC | NEG | fais-IND.PRES, | tu-NOM | dois-IND.PRES | comprendre | la-ACC | fait-P.PASSE-ACC | sentence-ACC. |
et si tu ne fais pas cela, tu dois comprendre la sentence qui a été prise. (coapollo,ApT :5.5. 71 ; 1050)
| Hlaford | Apolloni, | gif | ðu | þissere | hungrigan | ceasterwaru | gehelpest, | na | þæt | an | þæt | we | willað | þinne | fleam | bediglian. |
| Seigneur-NOM | Apollonius, | si | tu-NOM | ces | affamés | habitants | aides-IND.PRES, | nullement | ce-DAT | un seul | que | nous-NOM | IND.PRES | cette-ACC | fuite-ACC | cacher. |
Seigneur Apollonius, si tu aides ces habitants affamés, non seulement nous lui cacherons ta fuite, (mais) ... (coapollo,ApT :9.18.164)
Illustrons la structure (32) avec l´exemple (48), désormais (50.a) :
| and | gif | ðu | þæt | ne | dest, | þu | scealt | oncnawan | þone | gesettan | dom. |
| et | si | tu-NOM | cela-ACC | NEG | fais-IND.PRES, | tu-NOM | dois-IND.PRES | comprendre | la-ACC | fait-P.PASSE-ACC | sentence-ACC. |
et si tu ne fais pas cela, tu dois comprendre la sentence qui a été prise. (coapollo,ApT :5.5. 71 ; 1050)
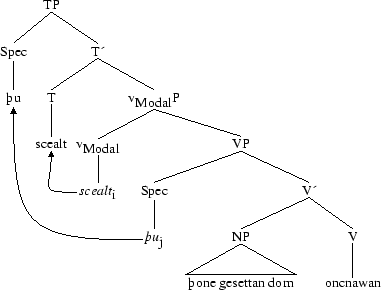
Lorsque nous avons affaire à la négation, la particule adverbiale négative (selon la terminologie utilisée dans la littérature en diachronie) ne précède immédiatement le verbe fini,
| ... | no | ðu | ymb | mines | ne | þearft | lices | feorme | leng | sorgian. |
| ... | ni | tu-NOM | à propos | moi-GEN | NEG | est nécessaire-IND.PRES | corps-GEN | réconfort par la nourriture-DAT | plus longtemps | s´affliger. |
... ni n´as-tu besoin de t´occuper plus longtemps de mon corps. (cobeowul,16.448.374 ; 680)
| ða | hine | Wedera | cyn | for | herebrogan | habban | ne | mihte. |
| étant donné que | le-ACC | sud de la Scandinavie-GEN | peuple-NOM | à cause de | terreur de la guerre-DAT | obtenir | NEG | peut-PRET. |
après cela, le peuple de Wedera ne le gardera pas. (cobeowul,16.459.386)
| Ða | ne | meahte | he | eaðelice | þa | unstillnesse | onfallendra | mengu | aberan... |
| Alors | NEG | put-PRET | il-NOM | facilement | la-ACC | agitation-ACC | écrasante-GEROND-GEN | foule-GEN | supporter... |
Il ne put alors pas facilement supporter l´agitation oppressante de la foule... (cobede,Bede_3 :14.216.32.2220 ; 890)
| ac | he | ne | mihte | hine | þar | findan | on | ðam | flocce. |
| mais | il-NOM | NEG | pouvait-PRET | lui-ACC | là | trouver | dans | les | troupes-DAT. |
mais il ne pouvait le trouver parmi les troupes. (coapollo,ApT :13.9.232)
De plus, il y a fusion de cette particule adverbiale sur ce type particulier de verbes (et, plus précisément sur les verbes AGAN, WILLAN et WITAN (note: ➳)), comme le montrent les exemples suivants :
| and | hi | noldon | me | þa | agifan. |
| et | ils-NOM | NEG+voulaient-IND.PRET | me | elle-ACC | rendre. |
et ils ne voulaient pas me la rendre. (coapollo,ApT :50.10.534 ; 1050)
| Nat | he | þara | goda | þæt | he | me | ongean | slea. |
| NEG+connaît-PRES | il-NOM | ces-GEN | outils-GEN | que | il-NOM | moi-DAT | contre | tue-SUBJ.PRES. |
Il ne connaît pas de bons outils avec lesquels se battre contre moi. (cobeowul,22.681.574 ; 680)
| ... | þæt | he | þa | weorþuncge | Eastrena | on riht | ne | heold | ne | nyste. |
| ... | ce que | il-NOM | le-ACC | culte-ACC | Pâques-GEN | correct-ACC | NEG | respectait-IND.PRET | ni | NEG+connaissait-PRET. |
... what he imperfectly understood in relation to the observance of Easter ce qu´il ne comprenait qu´imparfaitement du culte de Pâques. (cobede, Bede_3 :14.206.1.2087 ; 890)
Chose frappante, ce phénomène de fusion, même s´il n´est pas obligatoire, ne se produit que sur cette classe particulière de verbes (et sur wesan et habban), mais pas sur les verbes forts et ni sur les verbes faibles.
Résumons donc les différences des verbes perfecto-présents :
Ils entretiennent une relation particulière avec la négation, puisqu´il peut y avoir fusion entre la particule adverbiale négative et le perfecto-présent.
Morphologiquement, ils se différencient des autres classes de verbes du point de vue de leur flexion verbale. Le pluriel du présent de l´indicatif n´est pas identique à celui des verbes forts et faibles, et il y a alternance vocalique entre la forme infinitive et les formes du présent de l´indicatif.
Les perfecto-présents peuvent généralement avoir pour complément :
un NP objet (substantif ou pronom), comme les autres classes de verbes,
un VP dans lequel est présent un infinitif (pour les verbes forts et faibles, l´infinitif appartient soit à un TP, soit à un CP).
Lorqu´un infinitif suit un verbe lexical (fort ou faible), celui-ci appartient à un TP ou un CP selon le type de verbe (une analyse plus approfondie est faite dans la section suivante (note: ➳)). La structure de ces phrases (hormis les causatives) est alors :
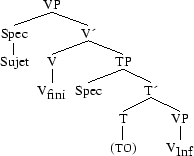
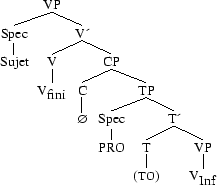
| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |
| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |
Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)
| ... | þæt | seolfe | he | ne | blinneþ | mærsian | & | weorþian | a | butan | ende. |
| ... | que | même-NOM | il-NOM | NEG | cesse-IND.PRES | glorifier | & | célébrer | toujours | sans | fin. |
... qu´il ne cesse jamais de [le] glorifier et de [le] célébrer sans fin. (cobede, Bede_5 :20.474.6.4756)
Prenons l´exemple (59) (maintenant (61.a)) et donnons-en la représentation (qui vaudra pour l´exemple (60)).
| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |
| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |
Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)
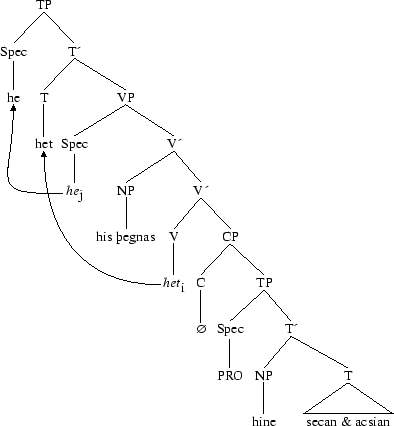
Tous les exemples que nous venons de donner nous permettent de dire que les verbes perfecto-présents, lorsqu´ils sont lexicaux, sont générés sous V. Lorsqu´ils sont semi-lexicaux, ils sont générés sous vModal, et nous émettons l´hypothèse que ce sont des verbes de montée ayant une structure ressemblant aux structures causatives de l´anglais contemporain. Ils fonctionnent comme des opérateurs, ils font partie de l´événement de la phrase, mais ils ne sont pas l´événement : en cela, ils sont « causatifs » (et ils semblent avoir une syntaxe similaire). De plus, ils ne possèdent pas d´argument externe (c´est-à-dire de sujet, le sujet étant celui du verbe non fini) et ils n´assignent pas de cas à leur complément. C´est le verbe à l´infinitif qui assigne le θ-role au sujet et à l´objet. Cependant, il y a accord visible entre le sujet et le perfecto-présent.
En début de chapitre, les différents exemples utilisés nous ont permis de définir trois têtes fonctionnelles : C, T et Neg (bien que nous n´ayons pas défini sa position syntaxique). Nous allons maintenant en définir une quatrième : petit v (que nous avons déjà introduit dans notre analyse), laquelle appartient aussi aux catégories fonctionnelles principales d´une phase. Dans Chomsky (1998) : 15, v est un « verbe léger », qui est la tête des constructions transitives. Il doit toujours être sélectionné par une catégorie fonctionnelle, T. v sélectionne à son tour un VP et un syntagme nominal (NP) (qui est alors l´argument externe de v). Tout comme C et T, il possède un trait EPP. Dans le cadre minimaliste, C et v définissent les phases fortes d´une dérivation. Illustrons notre propos en VA.
| ... | þa | cliopode | heo | hi | hire | to | mid | liðere | spræce. |
| ... | alors | appella-PRET | elle-NOM | lui-ACC | elle-DAT | à | avec | douce-DAT | parole-DAT. |
... elle l´appella alors à elle avec une douce parole. (coapollo,ApT :2.14.24)
La structure de cette phrase est la suivante :
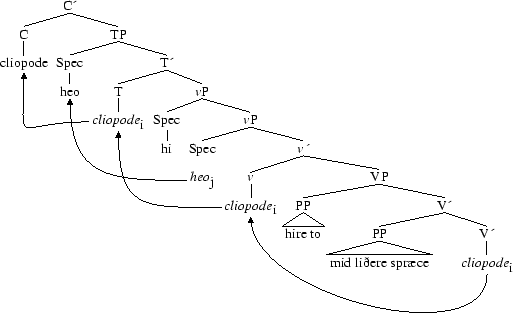
Dans cette structure, il y a deux phases fortes, vP et CP. Le locuteur choisit d´abord des éléments dans son lexique, chaque élément correspondant à une catégorie. Le verbe et les compléments sont générés sous VP, lequel est sémantiquement sélectionné par v. C´est pourquoi V fusionne avec v, qui est la tête de transitivité de la phrase, et la première phase forte. Le sujet en Spec,vP satisfait le trait EPP de TP. Il y a ensuite adjonction d´un Spec supplémentaire à vP, c´est l´argument interne qui occupe cette position.
Le locuteur choisit donc des éléments dans le lexique :
V = cliopode [+past,-irréel,+sg3],
NPSujet = heo [+sg3,+fem,+nom],
NPObjet = hi [+sg3,+masc,+acc],
PP = hire to [+sg3,+fem,+dat],
PP = mid liðere spræce [+dat].
Puis les composants choisis se mettent en place :
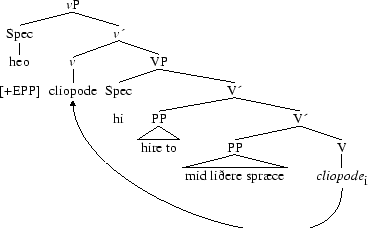
A ce stade, la dérivation peut capoter car les traits de temps du verbe et les traits de T n´ont pas été satisfaits. De fait, il ne peut y avoir Epélation. v va donc fusionner avec T et ainsi satisfaire les traits (ininterprétables) de temps de T, et le sujet en position Spec, vP va monter sous Spec,TP pour satisfaire les traits ϕ de T. Une fois satisfaits, les traits de temps et les traits ϕ du sujet sont effacés. L´épélation ne se fait toujours pas puisque TP n´est pas une phase forte. Comme nous l´avons mentionné, T est sémantiquement sélectionné par C. La fusion de l´adverbe de temps þa sous Spec,CP induit le mouvement de v à C. Dès lors, la dérivation est terminée et peut être épelée.
Nous venons de souligner l´existence d´une autre tête fonctionnelle, v. Nous laissons pour l´instant de côté la tête fonctionnelle Neg, que nous allons traiter plus loin.
Dans la Morphologie Distribuée (DM) de Halle et Marantz, et particulièrement dans Marantz (1999), v a les traits suivants :
Il identifie un verbe.
Il fournit une sémantique événementielle.
Il fournit une sémantique agentive pour les constructions agentives.
Il fusionne avec un argument externe.
Il entretient une relation d´accord avec l´objet (l´argument interne).
Selon Marantz, les traits 1 à 3 vont ensemble, c´est-à-dire le contenu sémantique de v agit sur la phrase. Pour un v particulier, on peut avoir les traits 1 à 3, sans les traits 4 et 5, tout comme on peut avoir les traits 4 et 5 sans les traits 2 et 3.
D´après notre hypothèse, vModal possède les traits 1, 2 et 3 : il identifie un verbe semi-lexical (que l´on peut considérer comme un « opérateur ») qu´est le perfecto-présent, il fournit une sémantique événementielle (il ajoute un complément d´information à la relation mise en place par le verbe non fini), et il pourrait fournir une sémantique agentive (cependant, un verbe de montée fournit-il une sémantique agentive ?). Mais il ne possède pas les traits 4 et 5 car l´argument externe fusionne avec le verbe non fini, et il n´y a pas d´accord avec le verbe infinitif (il ne lui assigne pas de cas).
A ce stade de notre travail, nous postulons donc l´existence de deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents :
La position V lorsque le perfecto-présent est transitif direct (suivi d´un NP), indirect (suivi d´un PP) ou bitransitif (suivi de deux objets).
Une position que nous nommons vModal, lorsque le perfecto-présent est transitif (le complément est un verbe infinitif (un VP)). Concernant cette dernière, elle est hiérarchiquement plus basse que T.
Pour notre analyse, il va être nécessaire de définir ce qu´est une structure infinitive, et la ou les différence(s) que l´on peut remarquer selon que le verbe fini est lexical ou semi-lexical.
L´analyse des sections précédentes nous permet de dire qu´il existe, en VA, deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents, selon qu´ils sont employés comme verbes lexicaux (suivi d´un objet), ou comme verbe semi-lexicaux (suivi d´un autre verbe à l´infinitif). Dans le premier cas, la position syntaxique est V, dans le second, c´est la position vModal. L´exemple qui suit illustre à nouveau cette première position syntaxique. Et dans les deux cas de figure, le sujet est généré sous Spec,vP (mais, lorsque vP est implicite dans nos structures, le sujet est sous Spec,VP).
| Ac | sio | ðeod | þone | cræft | þæs | fiscaþes | ne | cuðe, | ... |
| Mais | le-NOM | peuple-NOM | le-ACC | métier-ACC | la-GEN | pêche-GEN | NEG | connaissait-PRET, | ... |
Mais le peuple ne connaissait pas l´art de la pêche, ... (cobede,Bede_4 :17.304. 10.3076 ; 890)
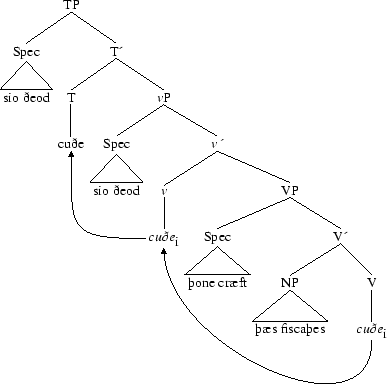
Quand le perfecto-présent n´a pas pour complément un NP, il a pour complément un VP dans lequel on trouve un verbe infinitif.
Regardons maintenant avec attention les structures infinitives dans lesquelles est présent soit un verbe lexical, soit un verbe perfecto-présent, et ce afin de définir les différences syntaxiques entre ces deux types de verbes.
En anglais contemporain, les propositions infinitives ont les structures suivantes, selon qu´il s´agit d´un verbe lexical (structures (66.b), avec TO, et (67.b), sans TO), ou d´un verbe modal (structure (68.b)) :
They want to stay.
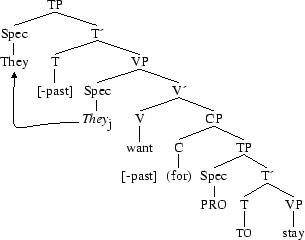
They heard John cry.
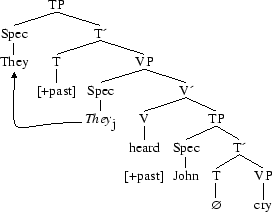
Mary can swim.
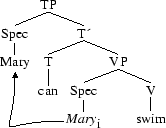
Le verbe à l´infinitif est le complément du modal, et il est généré sous VP. Concernant les autres types d´infinitives (dans lesquelles le verbe fini est un verbe lexical), ce sont des propositions : c´est une phrase complexe avec un verbe fini et un verbe non fini. Quant au V lexical, il ne monte pas à T, mais c´est l´affixe de temps qui va descendre à V, c´est ce qu´on appelle le saut de l´affixe (Affix Hopping).
Qu´en est-il maintenant en vieil-anglais ? Les propositions infinitives suivant les perfecto-présents appartiennent-elles à un VP (l´hypothèse que nous avons émise) ? Avant d´analyser ces propositions, intéressons-nous aux infinitives qui suivent un verbe (fini) lexical.
Dès la période VA, nous trouvons deux types de propositions infinitives : celles qui sont introduites par TO (exemples (69) à (75)), et celles qui ne sont pas introduites par TO (exemples (59) et (60)).
| ræd | eahtedon | hwæt | swiðferhðum | selest | wære | wið | færgryrum | to | gefremmanne. |
| conseil-ACC | considérèrent-IND.PRET | qui-NOM | vaillants-DAT | le meilleur-NOM | était-SUBJ.PRET | avec | horreur extrême-DAT | TO | suivre-DAT. |
(ils) cherchèrent un plan, ce qui serait le mieux de faire contre ces attaques affreuses pour les hommes vaillants qu´ils étaient. (cobeowul,8.171.138)
| No | þæt | yðe | byð | to | befleonne. |
| Nullement | cela-NOM | facile-NOM | est-IND.PRES | TO | disparaître-DAT. |
Il n´est pas facile de disparaître. (cobeowul,32.1002.835)
| and | þæt | gefremed | man | gewilnode | to | bediglianne. |
| et | cet-ACC | étranger-ACC | homme-ACC | désira-PRET | TO | cacher-DAT. |
et (il) désira cacher cet étranger. (ApolT,ApT :1.14.13)
| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |
| voulons-IND.PRES | le-ACC | venger | si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |
et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :33.127.447)
| & | het | him | to | gelangian | þa | ylcan | Gotan. |
| & | ordonna-IND.PRET | lui-DAT | TO | envoyer | les-ACC | mêmes-ACC | Goths-ACC. |
& il lui ordonna d´envoyer les mêmes Goths. (cogregdH,GD_1_[H] :10.80.10.794)
| Eft | þæs | on | mergen | het | se | manfulla | dema | þa | eadigan | Agnen | him | to | gefeccan. |
| Encore | cela-GEN | au | lendemain-ACC | ordonna-IND.PRET | le-NOM | méchant-NOM | juge-NOM | la-ACC | sainte | Agnes-ACC | lui-DAT | TO | chercher. |
Le lendemain matin, le méchant juge ordonna d´aller chercher à nouveau sainte Agnès. (coaelive,ÆLS[Agnes] :91.1774)
| Ða | cwæð | to | him | oþer | of | hys | leorningcnihtum, | Drihten, | alyfe | me | ærest | to | farenne | & | ∅ | bebyrigean | minne | fæder. |
| Alors | dit-IND.PRET | à | lui-DAT | autre-NOM | de | ses | disciples-DAT, | Seigneur-NOM, | permette-SUBJ.PRES | moi | auparavant | TO | aller-DAT | & | ∅ | enterrer | mon-ACC | père-ACC. |
Alors, un autre de ses disciples lui dit : que le Seigneur me permette d´aller d´abord enterrer mon père. (cowsgosp,Mt_[WSCp] :8.21.462)
Si l´on regarde attentivement ces exemples, nous remarquons que lorsqu´une proposition infinitive est introduite par TO, cet infinitif peut être marqué casuellement par un datif, ce qui ne semble pas être le cas lorsque TO est absent. C´est ce que l´on a vu dans l´exemple (72) : il y a ellipse du verbe non fini (ce qui montrerait que TO devient une tête fonctionnelle ; c´est ce que nous allons voir plus loin). Par contre, dans l´exemple (73), l´infinitif est non marqué. On peut alors se demander ce que représente syntaxiquement ce TO : est-ce la tête fonctionnelle que nous connaissons en AC, ou bien, est-ce une préposition qui régit le cas datif, ou encore, est-ce un item semi-lexical, auquel cas ce TO suivrait le même cheminement syntaxique que les perfecto-présents ? Au vu des exemples précédents, nous pouvons considérer TO comme une préposition semi-lexicale (i.e. qui se grammaticalise) qui régit le datif (voir Roberts, Roussou (2003)). Cependant, la représentation syntaxique de cet élément serait la tête fonctionnelle T possédant un trait [+dat] qui est vérifié par le trait [+dat] de l´infinitif (si ce trait est marqué).
Nous allons maintenant illustrer notre propos avec les trois exemples suivant : (76) où TO n´apparaît pas, (77) dans lequel le verbe non fini est précédé de TO et le sujet de la proposition infinitive est visible, et (79.a) dans lequel le sujet de l´infinitive (PRO) est contrôlé par le sujet de la phrase.
| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |
| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |
Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)
| and | þæt | gefremed | man | gewilnode | to | bediglianne. |
| et | cet-ACC | étranger-ACC | homme-ACC | désira-PRET | TO | cacher. |
et (il) désira cacher cet étranger. (coapollo,ApT :1.14.13)
Dont la structure est la suivante,
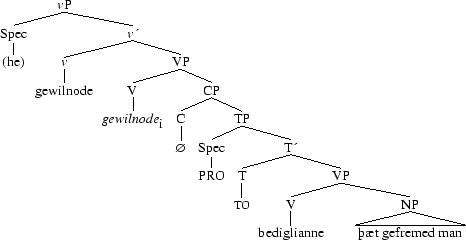
Quant à l´exemple
| No | þæt | yðe | byð | to | befleonne. |
| Nullement | cela-NOM | facile-NOM | est-IND.PRES | TO | disparaître-DAT. |
Il n´est pas facile de disparaître. (cobeowul,32.1002.835)
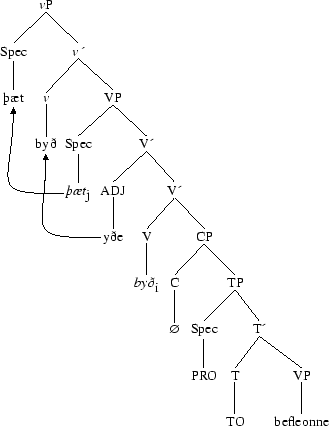
Dans les exemples (80) à (84), nous redonnons des occurrences de perfecto-présents suivis d´un infinitif dans les exemples (80) à (82), ils sont suivis d´une proposition infinitive dans laquelle le verbe non fini est réalisé, mais, dans les exemples (83) à (84), il y a ellipse du verbe non fini.
| ne | mihte | snotor | hæleð | wean | onwendan. |
| NEG | pouvait-PRET | sage-NOM | héros-NOM | tristesse-ACC | changer. |
ni le sage héros ne pouvait laisser de côté sa tristesse. (cobeowul,8.189.153)
| ic | geðristlæhte | þæt | ic | dorste | þis | weorc | ongynnan. |
| je-NOM | supposais-PRET | que | je-NOM | osais-PRET | ce-ACC | travail-ACC | commencer. |
je supposais que j´avais osé commencer ce travail. (cobede,BedePref :4.10.163)
| and | hi | noldon | me | þa | agifan. |
| et | ils-NOM | NEG+voulurent-IND.PRET | me | elle-DAT | donner. |
et ils ne voulurent pas me la donner. (coapollo,ApT :50.10.534)
| cwæð | heo : | Wilt | ðu, | wit unc | abidde | ondrincan. | Cwæð | ic : | Ic | wille | ∅... |
| dit-IND.PRET | elle-NOM : | veux-IND.PRES | tu-NOM, | nous deux-NOM | appeler-SUBJ.PRES | boire. | Dis-IND.PRET | je-NOM : | je-NOM | veux-PRES | ∅... |
elle dit, « Voudriez-vous que je fasse chercher quelque chose à boire ? » « Oui, » répondis-je, « j´en serais ravi si vous le pouviez. » (cobede,Bede_5 :3.392.32.3921)
| unc | sceal | worn | fela | maþma | gemænra | ∅, | siþðan | morgen | bið. |
| nous-DAT | doit-IND.PRES | beaucoup-NOM | nombreux | trésors-GEN | précieux-GEN | ∅, | puisque | matin-NOM | est-IND.PRES. |
(et) nous partagerons beaucoup de trésors précieux, dès que le matin sera là. (cobeowul,55.1782.1472)
En anglais contemporain, les verbes dits « causatifs » sont des verbes opérateurs : ils ne sont ni lexicaux ni auxiliaires, ils font partie de l´événement mais ils ne sont pas l´événement. Un verbe causatif est un v qui possède les traits 1 à 5 que nous avons déjà mentionnés dans la Section 2.4.1 : il identifie un verbe, il fournit un sémantique événementielle et agentive, il fusionne avec un argument externe et il entretient une relation d´accord avec l´objet. Redonnons quelques exemples de verbes causatifs en anglais contemporain, puis regardons le vieil-anglais afin de savoir si nous trouvons de telles occurrences.
He had them eat the cake.
He made him cry.
La structure de ce dernier exemple est,
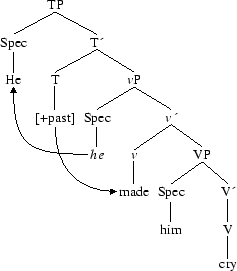
Dans les structures causatives de l´anglais contemporain, le complément du verbe fini est un VP. Qu´en est-il en VA ? Nous avons regardé les occurrences du verbe don « causer, faire » :
| (...) | doð | foroft | drymen | & | wiccan | on | heora | scincræfte, | to | beswicenne... |
| (...) | causent-IND.PRES | très souvent | magiciens-NOM | & | devins-NOM | par | leur | magie-DAT, | TO | décevoir-DAT... |
Très souvent, par leur magie, les magiciens et les astrologues deçoivent... (coaelhom,ÆHom_18 :91.2543)
| Þone | oðerne | dæl | he | dyde | ∅ | gehealden | mid | him | to | bebyrgenne | æfter | his | forðsiðe. |
| Cette-ACC | autre-ACC | parole-ACC | il-NOM | causa-PRET | ∅ | observer | avec | lui-DAT | TO | enterrer-DAT | après | son-DAT | déces-DAT. |
il fit observer cette autre parole en sa présence pour lui ériger une sépulture après sa mort. (coaelive,ÆLS_[Basil] :123.531)
| and | dydon | on | wæter | wanhalum | to | þicgenne, | ... |
| et | causèrent-IND.PRET | sur | eau-ACC | croupie-DAT | TO | boire-DAT, | ... |
et ils firent boire cette eau croupie, ... (coaelive,ÆLS_[Oswald] :200.5496)
| Ond | heo | leornunge | godcundra | gewreota | hire | underþeodde | dyde | to | bigongenne, | ... |
| Et | elle-NOM | savoirs-DAT | sacrés-GEN | écritures-GEN | elle-DAT | assujetti-P.PASSE-DAT | causa-PRET | TO | suivre-DAT, | ... |
Et elle obligea ceux qui étaient sous sa direction d´assister à la lecture des Ecritures Saintes, ... (cobede,Bede_4 :24.334.16.3354)
Ce dernier exemple a la structure suivante (laquelle vaut pour les autres occurrences, même l´exemple (89) où le TO n´est pas visible) :
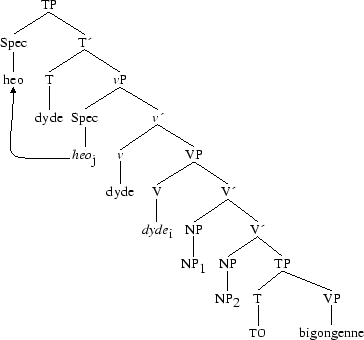
Au vu des ces exemples (peu nombreux dans notre corpus), la structure infinitive de ce verbe causatif en VA est un TP, et non un VP (comme l´anglais contemporain). En cela, ils diffèrent des perfecto-présents qui prennent pour complément un VP.
Revenons à nos exemples concernant ces derniers. Le perfecto-présent (fini) est suivi d´un infinitif dans (80) à (82). Dans les exemples (83) à (84), le verbe fini est seul, mais il y a ellipse de l´infinitif. Nous allons maintenant analyser la structure de ces verbes et montrer que le complément infinitif est bien un VP. De ce fait, nous pourrons différencier les verbes causatifs des verbes perfecto-présents et affirmer que les verbes causatifs sont des V, alors que les perfecto-présents sont des vModal (car, selon l´analyse de v dans Marantz (1999), notre vModal ne possède que trois traits sur cinq, dont deux ne concernent que la sémantique). Avant de commencer notre analyse, reprenons quelques exemples que nous avons déjà mentionnés :
| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |
| voulons-IND.PRES | le-ACC | venger | si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |
et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :33.127.448)
| ... | þæt | heo | his | wedenheortnisse | gestilden, | ac | heo | ne | meahton | ∅. |
| ... | que | il-NOM | sa | folie | apaisèrent-SUBJ.PRET, | mais | il-NOM | NEG | put-IND.PRET | ∅. |
... fit tout ce qu´il put pour apaiser la folie de ce pauvre homme, mais il n´y arriva pas. (cobede,Bede_3 :9.184.32. 1853)
| unc | sceal | worn | fela | maþma | gemænra | ∅, | siþðan | morgen | bið. |
| nous-DAT | doit-IND.PRES | beaucoup-NOM | nombreux | trésors-GEN | précieux-GEN | ∅, | puisque | matin-NOM | est-IND.PRES. |
(et) nous partagerons beaucoup de trésors précieux, dès que le matin sera là. (cobeowul,55.1782.1472)
La première étape de notre analyse va être de mettre en parallèle l´exemple (93) et les exemples (94) à (95). Les différents exemples dans lesquels l´infinitive était introduite par TO nous ont montré que ce même TO tendait à être une tête fonctionnelle (c´est-à-dire une préposition semi-grammaticale). L´exemple (93) nous confirme ce point : avec l´ellipse de la base verbale, TO est considéré ici comme une tête fonctionnelle (que nous supposons être T) ; si TO avait été une préposition, il n´y aurait pas eu ellipse du verbe. Nous proposons de faire un parallèle entre cette structure (où TO est, pensons-nous, généré sous T) et les structures (94) à (95) : cette analyse va nous permettre de montrer que la position, dans laquelle sont générés les perfecto-présents lorsqu´ils sont suivis d´un infinitif, est vModal. Le parallèle que nous faisons est donc le suivant : quand il y a ellipse du verbe non fini, les têtes accueillant TO et le perfecto-présent sont toutes deux des têtes « fonctionnelles ». La structure est alors sensiblement la même : à TO + V correspond la structure suivante :
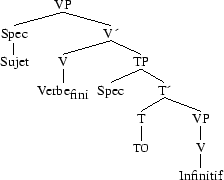
et à la structure Perf.Pres. + V correspond la structure suivante (dans laquelle le sujet est généré sous Spec,VP et fusionne avec Spec,TP : en ce sens, nous pouvons parler de structure de montée concernant les perfecto-présents, mais nous allons y revenir) :
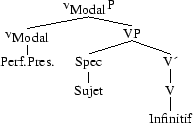
D´après cette structure, il semblerait donc que le perfecto-présent soit un verbe de montée : le sujet sémantique du verbe non fini monte à Spec,TP pour devenir le sujet grammatical (il y a alors accord visible avec le perfecto-présent).
Reprenons maintenant les exemples (93) et (94) (maintenant (98.a) et (99.a)) et donnons-en la structure.
| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |
| si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |
et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :127.446)
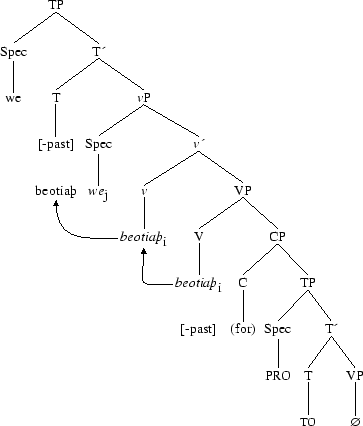
| þæt | heo | his | wedenheortnisse | gestilden, | ac | heo | ne | meahton | ∅. | |
| ... | que | il-NOM | sa | folie | apaisèrent-SUBJ.PRET, | mais | il-NOM | NEG | put-IND.PRET | ∅. |
... fit tout ce qu´il put pour apaiser la folie de ce pauvre homme, mais il n´y arriva pas. (cobede,Bede_3 :9. 184.32.1854)
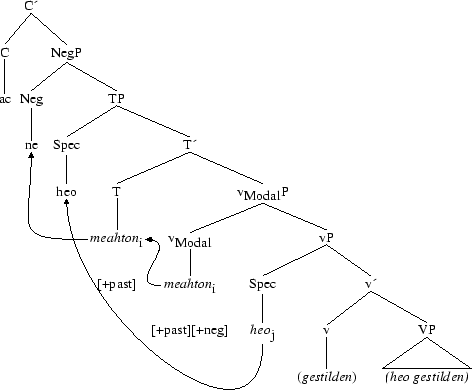
Affinons encore notre analyse des perfecto-présents afin d´accentuer la différence syntaxique d´avec les autres verbes. Les exemples que nous allons regarder sont :
des occurrences ayant la structure MD + INF + OBJ-ACC,
| Mæssepreost | sceal | habban | mæsseboc | and | pistelboc, | and | sangboc | and | rædingboc | and | saltere | and | handboc | (...). |
| Prêtre-NOM | doit-IND.PRES | avoir | livre de prière-ACC | et | livre des évangiles-ACC, | et | livre des chants-ACC | et | livre de lecture-ACC | et | psaumes-ACC | et | manuel-ACC | (...). |
Le prêtre doit posséder le livre des prières, le livre des évangiles, le livre des chants, celui des psaumes et le manuel. (colwstan1,ÆLet_2_[Wulfstan_1] :157. 226)
| Hwylc | man | is | þæt | mæge | ariman | ealle | þa | sar | & | þa | brocu | þe | se | man | to | gesceapen | is ? |
| Quel-NOM | homme-NOM | est-IND.PRES | que | puisse-SUBJ.PRES | énumérer | toute-ACC | la-ACC | souffrance-ACC | & | les-ACC | maladies-ACC | que | le-NOM | homme-NOM | à | destiné-P.PASSE | est-IND.PRES ? |
Quel est l´homme qui peut énumérer toute la souffrance et toutes les maladies auxquelles il est déstiné ? (coblick,HomS_17_[BlHom_5] :55.99.795)
| forþon | þe | heo | wolde | gehyran | his | word | & | his | lare. |
| parce | que | elle-NOM | voulait-PRET | entendre | sa | parole-ACC | & | son | savoir-ACC. |
car elle voulait entendre sa parole et son savoir. (coblick, HomS_21_[BlHom_6] :67.30.825)
| Hwæt, | hi | eac | witon | hwær | hi | eafiscas | secan | þurfan, | ... |
| Quoi, | ils-NOM | ainsi | savent-IND.PRES | où | ils-NOM | poissons de rivière-ACC | chercher | ont besoin-IND.PRES, | ... |
Quoi, ils savent donc où chercher les poissons dont ils ont besoin, ... (cometboe,176.19.24.318)
des occurrences ayant la structure MD + OBJ-ACC + INF,
| Tealde | & | wende | þæt | he | mid | swinglan | sceolde | þa | beldu | & | þa | anrednesse | his | heortan | anescian, | ða | he | mid | wordum | ne | mihte. |
| dit-PRET | & | traduisit-PRET | que | il-NOM | avec | coup de fouet-DAT | devait-PRET | le-ACC | courage-ACC | & | la-ACC | persévérance-ACC | son | cœur-GEN | affaiblir, | que | il-NOM | avec | paroles-DAT | NEG | pouvait-PRET. |
il dit et traduisit qu´il devait affaiblir le courage et la persévérance de son cœur en se flagellant, ce qu´il ne pouvait pas faire par les mots. (cobede,Bede_1 :7. 36.32.307)
| ac | he | ma | wile | his | treowa | & | his | gehat | wið | þe | gehealdan... |
| mais | il-NOM | plus | veut-PRES | son | accord-ACC | & | sa | promesse-ACC | avec | toi | tenir... |
mais il ne voudra plus tenir sa promesse envers toi... (cobede,Bede_2 :9. 130.24.1253)
| þæt | us | mæg | þa | gyfe | syllan | ecre | eadignesse | & | eces | lifes | hælo. |
| cela-NOM | nous | peut-IND.PRES | le-ACC | don-ACC | donner | éternelle-GEN | bonheur-GEN | & | éternelle-GEN | vie-GEN | salut-ACC. |
cela peut nous faire don du salut, du bonheur et de la vie éternelles. (cobede,Bede_2 :10.136.15.1320)
| Nu | nealæceþ | þæt | we | sceolan | ure | æhta | & | ure | wæstmas | gesamnian. |
| Maintenant | approche-IND.PRES | que | nous-NOM | devons-IND.PRES | nos-ACC | biens-ACC | & | nos-ACC | fruits-ACC | unir. |
Le temps est proche maintenant où nous devons rassembler nos biens. (coblick, HomS_14_[BlHom_4] :39.1.509)
| Sum | mæg | ryne | tungla | secgan. |
| Certain-NOM | peut-IND.PRES | course-ACC | étoiles-ACC | dire. |
Certains peuvent prédire la course des étoiles. (cochrist,21.671.453)
| ... | þæt | he | sceolde | boccræftas | & | gewrita | wisdomas | leornian. |
| ... | que | il-NOM | devait-PRET | science-ACC | & | écritures-GEN | savoir-ACC | apprendre. |
... qu´il devait apprendre la science et le savoir des écritures. (cogregdC, GDPref_2_[C] :95.10.1078)
| Næ | mæg | ic | ana | eower | gemang | acuman | & | eower | swarnyssa | & | eowre | saca. |
| Nullement | peut-IND.PRES | je-NOM | un | votre-ACC | assemblée-ACC | endurer | & | votre-ACC | lenteur-ACC | & | vos-ACC | ennemis-ACC. |
Je ne peux en aucun cas supporter ni votre assemblée, ni votre lenteur, ni vos ennemis. (cootest,Deut :1.11.4454)
des occurrences ayant la structure V + INF + OBJ-ACC,
| Þa | heht | heo | gesomnian | ealle | þa | gelæredestan | men | & | þa | leorneras : |
| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | rassembler | tous-ACC | les-ACC | ecclésiastiques-ACC | hommes-ACC | & | les-ACC | disciples-ACC... |
On lui ordonna, en présence de tous les hommes savants... (cobede, Bede_4 :25.344.20.3463)
| Broðor | mine, | nu | we | gehyrdon | secgan | þa | weorðunga | þyses | ondweardan | dæges... |
| Frère-NOM | mien-NOM, | maintenant | nous-NOM | entendions-IND.PRET | dire | le-ACC | célébration-ACC | ce-GEN | présent-GEN | jour-GEN... |
Mon frère, nous avons alors entendu parler de cette célébration du présent jour... (coblick,HomS_47_[BlHom_12] :137.106.1661)
| & | het | sceawian | ðæt | land | & | ða buruh | Iericho, | ... |
| & | souhaita-IND.PRET | regarder | ce-ACC | pays-ACC | & | la-ACC ville-ACC | Jéricho, | ... |
il souhaita visiter ce pays et la ville de Jéricho, ... (cootest,Josh :2.1.4382)
des occurrences ayant la structure V + OBJ-ACC + INF,
| Þa | het | se | cyning | sona | neoman | þone | mete | & | þa | swæsendo... |
| Alors | ordonna-IND.PRET | le-NOM | roi-NOM | bientôt | prendre | cette-ACC | vinade-ACC | & | cette-ACC | nourriture-ACC... |
Bientôt le roi ordonna que l´on dispose la viande et la nourriture devant lui... (cobede, Bede_3 :4.166.6.1591)
Avec ces exemples, nous allons essayer de montrer que la syntaxe des verbes lexicaux et des perfecto-présents est différente lorsque l´objet est marqué à l´accusatif : vModal n´assigne pas de cas, et sémantiquement, l´objet est lié à un V lexical.
Nous proposons donc que dans les structures où apparaissent des perfecto-présents, l´objet, qu´il soit placé entre le modal et l´infinitif, ou après l´infinitif, est sémantiquement lié au V infinitif : il est effectivement l´objet de ce V (il en est de même pour le sujet qui sera sémantiquement celui du V, avant de devenir le sujet grammatical du perfecto-présent). Nous émettons l´hypothèse que les perfecto-présents, dans ces structures, sont des verbes de montée, et ce dès le vieil-anglais.
Par contre, dans les structures où nous avons deux verbes lexicaux (V fini, V non fini), deux cas pourront se présenter : soit l´objet est lié au verbe fini (c´est ce verbe qui assigne le cas à l´objet), soit il est lié au verbe non fini, et, dans ce cas, il est le sujet de ce verbe non fini.
Dans le corpus VA, lorsque nous avons regardé les occurrences des verbes perfecto-présents et verbes lexicaux confondus, plus de deux tiers présentent des perfecto-présents, quant au dernier tiers, on trouve majoritairement des exemples avec deux verbes lexicaux : hetan et habban.
Ces exemples nous permettent de souligner la syntaxe des perfecto-présents, et de valider notre hypothèse d´un vModal : les objets marqués à l´accusatif sont sémantiquement ceux des verbes non finis. Il apparaît donc que les perfecto-présents, syntaxiquement, ne fonctionnent pas de la même manière que les verbes lexicaux.
Nous remarquons aussi que les objets marqués à l´accusatif sont les objets sémantiques des verbes finis, à la différence des perfecto-présents qui n´ont pas d´objet (autre que le VP).
On en déduit donc que les perfecto-présents ne sont pas des verbes lexicaux en VA (mais semi-lexicaux) : ce ne sont pas des V puisqu´ils n´ont pas d´objets auxquels ils peuvent assigner un cas accusatif. De plus, dès cette époque primitive, les perfecto-présents sont des verbes de montée. Ces deux comportements syntaxiques nous permettent de dire que ces mêmes verbes sont ainsi générés sous une position syntaxique différente de V : vModal.
Nous venons de voir que pour les verbes perfecto-présents, nous pouvions trouver deux types de structures :
Perf.Pres + NP ou,
Perf.Pres + Infinitif (VP).
Dans le premier cas, le perfecto-présent est un verbe lexical comme les verbes forts et les verbes faibles. Dans le second cas (et c´est ce que nous venons de voir), quand il est suivi d´un infinitif, il est directement généré sous vModal, mais le sujet est lui généré sous Spec,vP. Nous avons donc proposé que la tête fonctionnelle vModal domine V dans la hiérarchie syntaxique. A cette période de la langue, les perfecto-présents ne sont pas encore grammaticaux (et ne peuvent donc pas encore être générés sous T). C´est pour cela qu´on les a appelés semi-lexicaux.
Les exemples qui suivent (avec WITAN et MUNAN notamment) illustrent le statut lexical des perfecto-présents. La syntaxe peut être Pref.Pres + NP ou Pref.Pres + CP.
| ... | wite | þu | þæt | Apollonius | ariht | arædde | mynne | rædels ? |
| ... | sais-PRES | tu-NOM | que | Apollonius-NOM | bien | a interprété-PRET | mon-ACC | énigme-ACC ? |
... sais-tu qu´Apollonius a bien interprété mon énigme ? (coapollo,ApT :6.1.76)
| Ac | gemyne | þu | þæt | þu | þisne | ele, | þe | ic | þe | nu | sylle, | synd | in | þa | sæ. |
| Mais | te rappelles-IND.PRES | tu-NOM | que | tu-NOM | ces-ACC | huiles-ACC, | lesquelles | je-NOM | toi | toujours | produis-PRES, | sont-IND.PRES | dans | la-ACC | mer-ACC. |
Mais souviens-toi que tu dois jeter l´huile que je t »ai donnée à la mer. (cobede,Bede_3 :13.200.4.2025)
| wolde | þæt | he | in | þon | ongete, | þæt | þæt | mon | ne | wæs, | se | þe | him | æteawde, | ... |
| voulut-PRET | que | il-NOM | à travers | cela-INSTR | sût-SUBJ.PRET, | que | cet-NOM | homme-NOM | NEG | était-IND.PRET, | celui-NOM | que | lui-DAT | révéla-PRET, | ... |
Grâce à cela, il voulut qu´il sût que cet homme n´était pas celui qui le révélât, ... (cobede,Bede_2 :9.130.16.1245)
| men | ne | cunnon | hwyder | helrunan | hwyrftum | scriþað. |
| hommes-NOM | NEG | savent-IND.PRES | où | monstres démoniaques-NOM | sortie-DAT | va-IND.PRES. |
les hommes ne savent pas où les monstres sortis des enfers se dirigent. (cobeowul,7.162. 127)
Nous venons donc de définir deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents : V, qui est la position syntaxique d´un perfecto-présent employé lexicalement, puis vModal, pour un perfecto-présent employé semi-lexicalement (i.e. suivi d´un infinitif).
Le perfecto-présent semi-lexical est donc directement généré sous vModal. Il fusionne ensuite avec T pour satisfaire ses traits de temps et ses traits ϕ (avec Spec,TP).
Reprenons l´exemple (33), maintenant (119.a), afin d´illustrer ce qui vient d´être dit.
| ... | þæt | he | wið | ælfylcum | eþelstolas | healdan | cuðe, | ða | wæs | Hygelac | dead. |
| ... | que | il-NOM | contre | ennemis-DAT | ville royale-ACC | administrer | sut-PRET, | depuis que | était-IND.PRET | Hygelac-NOM | mort-NOM. |
... qu´il sut administrer la ville royale contre les ennemis depuis la mort de Hygelac. (cobeowul,73.2367.1931)
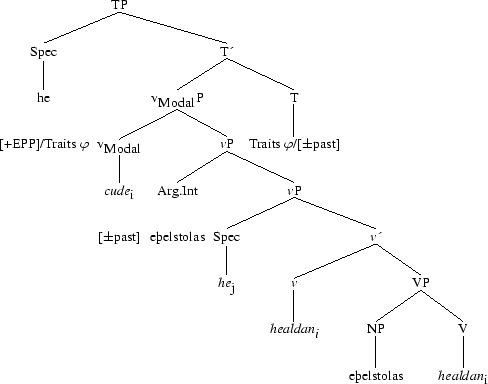
L´infinitif assigne un θ-rôle au sujet. Le perfecto-présent est alors généré sous vModal. Pour que la dérivation ne capote pas, le sujet monte à Spec,TP, afin de satisfaire le trait [+EPP] de T. Puis, le perfecto-présent satisfait son trait de temps avec celui de T, et ses traits ϕ avec ceux du sujet sous Spec,TP. Une fois ces traits satisfaits, la dérivation peut être épelée.
Revenons maintenant à la tête fonctionnelle Neg. Les exemples (23) et (24) nous ont montré qu´il pouvait y avoir cliticisation de la particule adverbiale négative ne sur le perfecto-présent, et que cette particule précédait toujours immédiatement le verbe fini. Mais nous allons voir que cette cliticisation n´est pas obligatoire.
Comme dans toutes les langues germaniques, le VA connaît le phénomène de concordance négative : si dans une phrase il y deux constituants négatifs (ou plus), ceux-ci ne s´annulent pas, mais expriment conjointement une seule et même négation (voir Haegeman, Haeberli (1995)).
| Siððan | of | þære | tide | nænig | Sceotta | cyninga | ne | dorste | wið | Angelþeode | to | gefeohte | cuman | oð ðysne | andweardan | dæg. |
| Quand | de | cette-DAT | période-DAT | aucun | Ecosse-GEN | rois-GEN | NEG | a osé-PRET | contre | Angleterre | pour | combat-DAT | approcher | jusqu´ici-ACC | présent-ACC | jour-ACC. |
A paritr de ce moment-là, aucun des rois d´Ecosse n´a osé aller combattre l´Angleterre. (cobede,Bede_1 :18.92.24.856)
| ... | no | ðu | ymb | mines | ne | ðearft | lices | feorme | leng | sorgian. |
| ... | ni | tu-NOM | à propos | moi-GEN | NEG | est nécessaire-IND.PRES | corps-GEN | repos-DAT | plus longtemps | s´affliger. |
... ni n´as-tu besoin de t´occuper plus longtemps de mon corps. (cobeowul,16.448.374)
| forðam þe | Apollonius | him | ondræt | þines | rices | mægna | swa þæt | he | ne | dear | nahwar | gewunian. |
| car | Apollonius-NOM | lui-même-DAT | redoute-IND.PRES | ce-GEN | royaume-GEN | puissance-ACC | de sorte que | il-NOM | NEG | ose-IND.PRES | nulle part | habiter. |
car Apollonius lui-même redoute la puissance de son royaume, de sorte qu´il n´ose aller habiter nulle part ailleurs. (coapollo,ApT :7.17.108)
Selon Haegeman (1995), le critère Neg détermine la syntaxe des phrases négatives. Dans ces phrases, tous les « N-words carry a semantic-syntactic feature Neg and this feature is subject to a specific licensing condition »(note: ➳). D´où l´introduction d´un critère Neg : « a NEG operator must be in a spec-head configuration with a X0 [+NEG] ; and an X0 [+NEG] must be in a spec-head configuration with a NEG operator » (Haegeman (1997) : 116) (note: ➳). Le critère Neg s´inspire du critère WH de Rizzi.
Dans le cadre minimaliste, ce n´est pas la relation Spec-tête qui est importante, mais la manière dont cette relation est satisfaite par la c-commande locale (recherche minimale dans un domaine minimal) : « Apparent SPEC-H relations are in reality head-head relations involving minimal search (local c-command) » (Chomsky (2001) : 12). On peut alors reformuler le critère Neg : toute tête négative doit être dans une relation de tête à tête avec un opérateur négatif, réalisé ou pas, dans son domaine minimal de recherche ; la tête négative c-commande alors localement un opérateur négatif.
Revenons maintenant à la particule adverbiale négative ne. Selon l´analyse de Zanuttini dans Haegeman (1997), puisqu´elle précède le verbe fini, et qu´elle n´a pas besoin d´un autre constituant négatif pour qu´une phrase soit négative, la particule adverbiale ne est la tête d´une projection négative NegP. Reste à savoir où est située cette projection fonctionnelle. En suivant Zanuttini, nous proposons la position suivante :
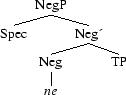
Donnons maintenant l´illustration de la position NegP avec l´exemple (124).
| ac | he | ne | mæg | for | scame | in | gan | buton | scrude. |
| mais | il-NOM | NEG | peut-IND.PRES | par | pudeur | dans | aller | sans | vêtements-DAT. |
par pudeur, il ne peut pas entrer sans vêtements. (coapollo,ApT :14.15.267)
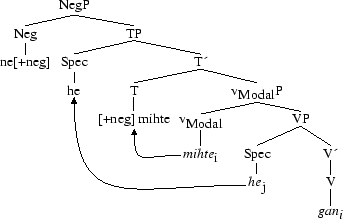
D´après le programme minimaliste de Chomsky, les constituants d´une phrase sont choisis dans le lexique déjà fléchis, c´est-à-dire que les noms ou les verbes portent les marques du singulier ou du pluriel, du genre, du nombre, de la personne, ... : ces marques représentent un ensemble de traits. Dès lors, pour qu´une dérivation soit grammaticale, chaque constituant doit voir son ensemble de traits satisfait par une catégorie (fonctionnelle) possédant les mêmes traits. Il en est de même pour la négation : celle-ci est choisie en même temps que le verbe fini, et possède un trait ininterprétable [+neg], lequel est satisfait par la tête fonctionnelle Neg, qui possède ce même trait. En même temps que la satisfaction de ce trait, il y a fusion de la tête Neg avec la tête T.
Selon la Morphologie Distribuée de Halle et Marantz, nous avons les étapes suivantes :
Nous avons d´abord, avant la fusion morphologique de T avec vModal,
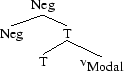
puis après la fusion morphologique de T et vModal,
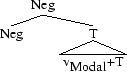
enfin, après la fusion morphologique de la tête Neg au complexe T+vModal,
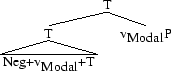
Une fois ces différentes fusions morphologiques effectuées, il y a insertion lexicale.
A ce point de notre analyse, la phrase VA possède une tête fonctionnelle Neg. Dans notre corpus, nous n´avons trouvé que très peu d´exemples où apparaît not. Quand celui-ci apparaît conjointement à la particule adverbiale négative ne (il ne peut pas être la seule négation de la phrase à cette période de la langue), il est considéré comme un quantifieur négatif (dans le corpus VA Pintzuk, Leendert (2001) et (Taylor, Warner, Pintzuk, Beths (2003)). Cependant, il est marqué ACC, ce qui en fait le COD du verbe infinitif.
| Þa | ondswared | he | þæt | he | noht | swylcra | cræfta | ne | cuðe. |
| Alors | répondit-PRET | il-NOM | que | il-NOM | rien-ACC | tel-GEN | métier-GEN | NEG | connaissait-PRET. |
Il répondit alors qu´il ne connaissait rien d´un tel métier. (cobede,Bede_4 :23.328. 8.3291)
| & | cwæð : | Ne | con | ic | noht | singan. |
| & | dit-PRES : | NEG | sais-IND.PRES | je-NOM | rien-ACC | chanter. |
et il dit : je ne sais rien chanter. (cobede,Bede_4 :25.342.29.3445)
| ... | forþon | ic | naht | singan | ne | cuðe. |
| ... | car | je-NOM | rien-ACC | chanter | NEG | savait-PRET. |
... car je ne savais rien chanter. (cobede,Bede_4 :25.342.29.3446)
Dans ces cas-là, le critère Neg s´applique : il y a une relation entre Neg et le N négatif.
Illustrons l´exemple (130) :
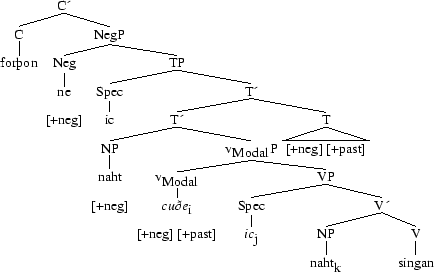
Le critère Neg se met en place, sans que T bloque la relation de c-commande locale entre la tête Neg, ne et Q, naht. Puis, au niveau morphologique, il va y avoir fusion partielle de la tête Neg et de la tête T (pour avoir l´ordre linéaire ne).
Le VA peut avoir plusieurs constituants négatifs qui n´expriment qu´une seule et même négation, ne peut alors être associé à des adverbes négatifs. Dans l´optique de Cinque (1999), pouvons-nous dire qu´à ces adverbes négatifs correspondent des Specs de têtes fonctionnelles ? Notre hypothèse est qu´à chaque type d´adverbes correspond une tête fonctionnelle. Regardons quelques exemples.
| forðam þe | Apollonius | him | ondræt | þines | rices | mægna | swa þæt | he | ne | dear | nahwar | gewunian. |
| car | Apollonius-NOM | lui-même-DAT | redoute-IND.PRES | le-GEN | royaume-GEN | puissance-ACC | de sorte que | il-NOM | NEG | ose-IND.PRES | nulle part | habiter. |
car Apollonius lui-même redoute la puissance de son royaume, de sorte qu´il n´ose aller habiter nulle part ailleurs. (coapollo,ApT :7.17.108)
| Ond | he | þes | biscop | ricum | monnum | no | for | are | ne | for | ege | næfre | forswigian | nolde, | ... |
| Et | il-NOM | cet-NOM | évêque-NOM | puissants-DAT | hommes-DAT | ni | à cause de | prospérité | ni | à cause de | crainte | jamais | cacher | NEG voulut-PRET, | ... |
Il ne donnait jamais d´argent aux homme puissants (...) s´il lui arrivait de les divertir, ... (cobede,Bede_3 :3.162.12.1557)
Les exemples (133) et (134) montrent l´utilisation de ne conjointement avec un adverbe négatif (rappelons que les adverbes sont générés in situ). Quant à l´exemple (135), la seule négation de la phrase est l´adverbe négatif.
| Na | þu | minne | ðearft | hafalan | hydan... |
| Nullement | tu-NOM | ma-ACC | as besoin-IND.PRES | tête-ACC | cacher... |
Tu n´as vraiment pas besoin de cacher ma tête... (cobeowul,16.445.368)
Nous avons mentionné que le Critère Neg impliquait une relation de tête à tête. Aussi, les différents adverbes négatifs seront des têtes pour que le Critère Neg puisse s´appliquer.
Ainsi, l´adverbe de lieu nahwar dans l´exemple (133) et l´adverbe de temps næfre dans l´exemple (134) sont tous deux positionnés sous une tête Adv. La tête Neg c-commande alors ces deux adverbes (AdvPLieu et AdvPTemps). L´exemple (135) est plus intéressant : si l´adverbe est la seule négation de la phrase, où est-il positionné ? Nous proposons qu´il soit généré sous une position différente de celles précédemment décrites. Ce n´est pas Spec,CP, puisqu´il n´y a pas inversion sujet-verbe (comme dans les phrases où le premier élément est un constituant négatif, ou les adverbes þa/þonne (voir van Kemenade (1987) et Pintzuk (1991))). Ce n´est pas Neg1, auquel cas l´adverbe précède immédiatement le verbe fini. Il existe alors une position au-dessus de TP où est généré ce type d´adverbes (de temps). Nous proposons une tête différente de Neg : le critère Neg pourra alors s´appliquer.
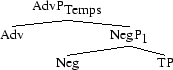
Reprenons l´exemple (135) (maintenant (137.a)), et donnons-en la structure.
| Na | þu | minne | þearft | hafalan | hydan... |
| Nullement | tu-NOM | mienne-ACC | as besoin-IND.PRES | tête-ACC | cacher... |
Tu n´as vraiment pas besoin de cacher ma tête... (cobeowul,16.445.368)
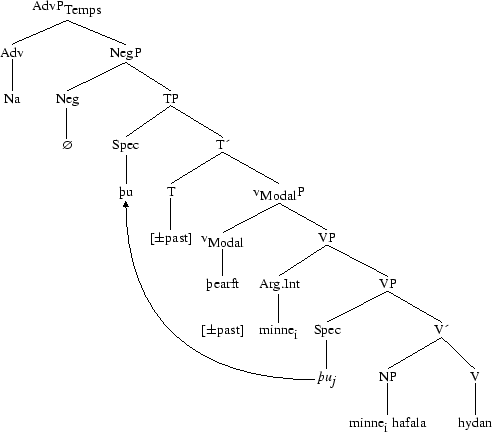
Sous Neg, nous avons placé un élément vide : même si ne n´est pas réalisé, le critère Neg s´applique effectivement.
Essayons maintenant de voir s´il existe autant de têtes fonctionnelles en VA qu´en anglais contemporain (nous suivons Cinque dans sa classification, sauf que nous considérons que les adverbes sont générés sous des têtes fonctionnelles (à chaque type d´adverbes correspond une tête fonctionnelle) et non des Specs). Pour ce faire, nous n´avons sélectionné que des exemples qui nous paraissaient pertinents, c´est-à-dire des exemples dans lesquels coexistent plusieurs adverbes, afin de voir si une hiérarchie existe.
| Nænig | heora | þohte | þæt | he | þanon | scolde | eft | eardlufan | æfre | gesecean... |
| Aucun | eux-GEN | pensèrent-PRET | que | il-NOM | de là | devait-PRET | souvent | maison aimée-ACC | jamais | chercher... |
Aucun d´entre eux ne pensait qu´à partir de ce moment il n´aurait jamais à chercher continuellement sa chère maison... (cobeowul,23.691.582)
| sceolde | hwæðre | swa | þeah | æðeling | unwrecen | ealdres | linnan. |
| devait-PRET | si | ainsi | cependant | prince-NOM | impuni-NOM | ancêtres-GEN | perdre. |
cependant un prince avait pu perdre la vie sans qu´il fût venger. (cobeowul,76.2441. 1992)
| þonne | wolde | heo | ealra | nyhst | hy | baþian | & | þwean. |
| alors | voulut-PRET | elle-NOM | tout-GEN | enfin | eux-ACC | baigner | & | laver. |
alors elle voulut enfin tous les baigner et les laver. (cobede,Bede_4 :21. 318.18.3198)
| se | sceal | nede | in | helle | duru | unwillsumlice | geniþerad | geladed | beon... |
| il-NOM | doit-IND.PRES | nécessairement | dans | enfer-GEN | porte-ACC | involontairement | condamné-P.PASSE-NOM | disculpé-P.PASSE | être... |
il sera très certainement damné et franchira la porte de l´enfer, qu´il le veuille ou non... (cobede,Bede_5 :15.442.21.4451)
| No | he | wiht | fram | me | flodyþum | feor | fleotan | mihte... |
| Nullement | il-NOM | rien | loin de | moi-DAT | vagues-DAT | loin | nager | pouvait-PRET... |
Il ne pouvait absolument pas nager loin de moi dans les vagues... (cobeowul,18.541.460)
| ne | mæg | ic | her | leng | wesan. |
| NEG | peux-IND.PRES | je-NOM | ici | plus longtemps | rester. |
je ne peux pas rester ici plus longtemps. (cobeowul,86.2799.2283)
| Nales | þæt | sona | þæt | innstæpe | & | ungeþeahtenlice | þæm | gerynum | onfon | wolde | þæs | Cristenan | geleafan... |
| Aucun | cela | immédiatement | cela-ACC | directement | & | rapidement | les-DAT | sacrements-DAT | recevoir | voulut-PRET | les-GEN | chrétiens-GEN | croyances-GEN... |
he would not immediately and unadvisedly embrace the mysteries of the Christian faith il ne voulut pas immédiatement et imprudemment embracer les mystères de la foi chrétienne... (cobede,Bede_2 :8.124.13.1180)
| Ðæt | hwæðre | æðelice | ongetan | meahton | ealle | þa | þæt | cuðon. |
| Cela-ACC | toutefois | tout à fait | comprendre | pouvaient-IND.PRET | tous-NOM | ce-NOM | que | connaisaient-IND.PRET. |
Toutefois, tous pouvaient comprendre tout à fait ce dont ils avaient connaissance. (cobede,Bede_4 :26.348.29.3518)
| ... | þæt | he | ðær | eac | swylce | bebyrged | beon | moste... |
| ... | que | il-NOM | là | aussi | ainsi | enterré-P.PASSE | être | devait-PRET... |
... qu´il devait alors être aussi enterré là... (cobede,Bede_4 :30.374.1.3735)
| Hwider | mæg | ic | nu | faran ? |
| Où | puis-IND.PRES | je-NOM | maintenant | aller ? |
Où puis-je aller maintenant ? (coapollo,ApT :12.9.198)
| Hat | him | findan | hwar | he | hine | mæge | wurðlicost | gerestan. |
| Ordonne-IMP | lui | trouver | où | il-NOM | lui-ACC | puisse-SUBJ.PRES | honorablement | se loger. |
Ordonne-lui de trouver un endroit où il puisse se loger convenablement. (coapollo,ApT :17.27.365)
Dans les exemples (149), (151), (153) et (155), les adverbes ont les positions suivantes :
| Nænig | heora | þohte | þæt | he | þanon | scolde | eft | eardlufan | æfre | gesecean... |
| Aucun | eux-GEN | pensèrent-PRET | que | il-NOM | de là | devait-PRET | souvent | maison aimée-ACC | jamais | chercher... |
Aucun d´entre eux ne pensait qu´à partir de ce moment il n´aurait jamais à chercher continuellement sa chère maison... (cobeowul,23.691.582)
qui a la structure suivante,
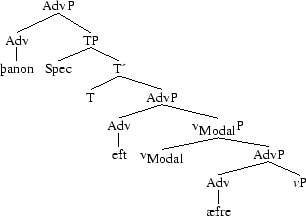
| sceolde | hwæðre | swa | þeah | æðeling | unwrecen | ealdres | linnan. |
| devait-PRET | si | ainsi | cependant | prince-NOM | impuni-NOM | ancêtres-GEN | perdre. |
cependant un prince avait pu perdre la vie sans qu´il fût venger. (cobeowul,76.2441. 1992)
qui a la structure suivante,
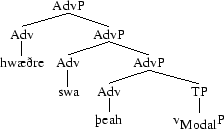
| þonne | wolde | heo | ealra | nyhst | hy | baþian | & | þwean. |
| alors | voulut-PRET | elle-NOM | tout-GEN | enfin | eux-ACC | baigner | & | laver. |
alors elle voulut enfin tous les baigner et les laver. (cobede,Bede_4 :21.318. 18.3198)
qui a la structure suivante,
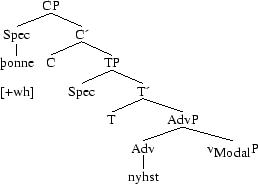
| se | sceal | nede | in | helle | duru | unwillsumlice | geniþerad | geladed | beon. |
| il-NOM | doit-IND.PRES | nécessairement | dans | enfer-GEN | porte-ACC | involontairement | condamné-P.PASSE-NOM | disculpé-P.PASSE | être |
Lui, que l´on a involontairement condamné aux portes de l´enfer, doit nécessairement être disculpé. (cobede,Bede_5 :15.442.21.4451)
qui a la structure suivante,
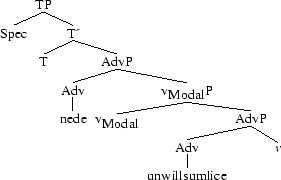
Regardons d´abord ces quatre exemples. Dans l´exemple (150), si l´on suit l´analyse de Cinque, les adverbes oft et æfre sont positionnés sous deux têtes fonctionnelles : AspFréquentatif et AspPerfectif, lesquelles suivent la hiérarchie de Cinque (1999) : 106. Nous avons alors une première structure :
[T [oft AspFréquentatif [vModal [æfre AspPerfectif]]]]
Dans l´exemple (156), nede et unwillsumlice sont aussi positionnés sous des têtes fonctionnelles. Celles-ci sont pertinentes pour notre analyse car ce sont des têtes modales, respectivement ModNécessité et ModVolition. Cela nous donne une seconde structure :
[T [nede ModNécessité [vModal [(un)willsumlice ModVolition]]]]
Pour Cinque, les têtes fonctionnelles Mod sont hiérachiquement plus hautes que les têtes Asp. Si nous récapitulons, nous obtenons la hiérachie suivante :
[T [nede ModNécessité [oft AspFréquentatif [ [(un)willsumlice ModVolition [æfre AspPerfectif]]]]]]
La structure précédente ne tient compte que des têtes Mod et Asp. Soyons maintenant plus précis en y ajoutant les têtes fonctionnelles correspondant aux autres adverbes mentionnés dans les exemples (150) à (156) :
[þonne AdvTemps [C [þanon AdvLieu [hwæðre [swa [þeah [T [nede ModNécessité [oft AspFréquentatif [ [(un)willsumlice ModVolition [æfre AspPerfectif [nyhst]]]]]]]]]]]]].
Cependant, ces quelques exemples n´illustrent l´emploi que d´un petit nombre d´adverbes. Voici un classement, selon les types d´adverbes, de tous ceux que nous avons rencontrés lorsqu´ils étaient employés avec des perfecto-présents. (note: ➳) Les textes de référence sont toujours Beowulf, Cura Pastoralis et Apollonius of Tyre. Nous tenterons ensuite de les hiérarchiser (selon la méthode de Cinque).
Adverbes de temps : a « toujours », æfre/næfre « toujours, jamais », ærest « premièrement », æror « avant », eac « depuis », emb « avant, après », fyrmest « premièrement », geara « bien, rapidement, près », gen « déjà, maintenant, encore », get « déjà, encore », iu « précédemment », leng « longtemps », nu « maintenant », oft « souvent », sel/selust « bientôt », seldon « rarement », somed « simultanément », sona « bientôt », symble « toujours », syððan « depuis, désormais, alors », toweardlice « vers le futur », þa/ þonne « alors », þonne « déjà » ;
Adverbes de lieu : ær « bientôt, déjà », emb « près », fyrr/feorr « loin », furður « vers », hider « de ce côté », nahwar « nulle part », þær « où », uute/utan « dehors », wide « loin et vastement » ;
Adverbes de modalité : aninga « nécessairement », eað « volontairement », lustlice « volontairement », nede « nécessairement », (un)willsumlice « volontairement »,
Adverbes de manière : aeðmodlice « humblement, gentiment », eað « légèrement », aninga « rapidement », fæstlice « constamment, strictement », fremsumlice « gentiment », freolslice « librement », fullice « parfaitement, complètement », furðum « exactement, déjà », fyrmest « spécialement », gearwe « bien, entièrement », geornlicor « précautioneusement », hergendlice « de manière louable », hrædlicor « soudainement », hu « comment », hwæðre « néanmoins, déjà », liðelice « doucement », lustlice « joyeusement », smealice « précisément, subtilement », somed « ensemble », sweotole/sweotollice « clairement, précisément », þonne « ainsi, déjà », uneaðelice « difficilement », wel « bien, entièrement ».
Autres types d´adverbes : eac « aussi », fordon « ainsi, parce que », hrædlicor « soudainement », hwædre « néanmoins, déjà », no « pas, jamais », swa « ainsi, en conséquence », þonne « ainsi, déjà ».
Reprenons maintenant la hiérarchie de Cinque (1999) : 106, et voyons si elle peut s´appliquer aux adverbes VA.
| [franklyMoodSpeech Act | |
| fortunatelyMoodEvaluative | |
| allegedlyMoodEvidential | sweotole/sweotollice, fullice, gewislicost, |
| gerisenlice, huru, openlicor, hluttorlice, | |
| rihtlice, smealice | |
| probablyModEpistemic | |
| onceT(Past) | eft, nu, iu, eac |
| thenT(Future) | þa/þonne, nu, teowardlice |
| perhapsMoodIrrealis | |
| necessarilyModNecessity | nede, aninga |
| possiblyModPossibility | |
| willinglyModVolitional | eað, lustlice |
| inevitablyModObligation | swa |
| cleverly, diligentlyModAbility/Permission | |
| usuallyAspHabitual | hioweslice |
| againAspRepetitive(I) | eft, gelomlice |
| oftenAspFrequentative(I) | eft, gelomlice |
| quicklyAspCelerative(I) | aninga |
| alreadyT(Anterior) | eac, emb, iu, syððan |
| no longerAspTerminative | |
| stillAspContinuative | get, gen, swa |
| alwaysAspPerfect | a/(n)æfre, simble |
| just, recentlyAspRetrospective | ær |
| soon, suddenly, immediatelyAspProximative | sona, sel/selust, hrædlicor |
| briefly, long timeAspDurative | leng |
| characteristicallyAspGeneric/Progressive | |
| almostAspProspective | neah |
| completelyAspSg.Completive(I) | fullice |
| tuttoAspPl.Completive | |
| wellVoice | wel, sel/selust, geara |
| fast/earlyAspCelerative(II) | aninga, geara |
| completelyAspSg.Completive(II) | fullice |
| againAspRepetitive(II) | eft, gelomlice |
| oftenAspFrequentative(II) | eft, gelomlice] |
Force est de constater que le VA ne semble pas posséder autant de têtes fonctionnelles qu´en anglais contemporain (même si certains adverbes n´entrent pas dans cette hiérarchie).
En l´état, nous obtenons les têtes fonctionnelles suivantes :
[sweotole/sweotollice clairement, précisément, fullice parfaitement, complètement, gewislicost certainement, sûrement, gerisenlice honorablement, de manière convenable, huru néanmoins, certainement, openlicor manifestement, hluttorlice sincèrement, clairement, rihtlice justement, bien, smealice précisément, subtilement MoodEvidential [eft encore, de nouveau, nu maintenant, iu précédemment, eac depuis T(Past) [þa/þonne alors, nu maintenant, teowardlice vers le futur T(Future) [nede nécessairement, aninga volontairement ModNecessity [eað volontairement, lustlice volontairement ModVolitional [swa ainsi, en conséquence ModObligation [hioweslice ? familièrement AspHabitual [eft encore, de nouveau, gelomlice fréquemment AspRepetitive(I) [eft encore, de nouveau, gelomlice fréquemment AspFrequentative(I) [aninga rapidement AspCelerative(I) [emb avant, après, iu précédemment, syððan depuis, désormais, alors, eac ? depuis T(Anterior) [get déjà, encore, gen déjà, maintenant, encore, swa ainsi, en conséquence AspContinuative [a/(n)æfre jamais, toujours, simble toujours, constamment AspPerfect [ær auparavant, autrefois AspRetrospective [sona bientôt, sel/selust bientôt, hrædlicor soudainement AspProximative [leng longtemps AspDurative [neah près, presque AspProspective [fullice parfaitement, complètement AspSg.Completive(I) [wel bien, sel/selust bientôt, geara jadis, autrefois Voice [aninga rapidement, geara jadis, autrefois AspCelerative(II) [fullice parfaitement, complètement AspSg.Completive(II) [eft encore, de nouveau, gelomlice fréquemment AspRepetitive(II) [eft encore, de nouveau, gelomlice fréquemment aAspFrequentati- ve(II)]]...
Dans la Section 2.8.2, certaines des têtes fonctionnelles que nous venons d´énumérer vont servir à notre analyse, notamment les têtes Mod(alité). Dans la Section 2.8.1, bien qu´une tête fonctionnelle ModeIrrealis n´apparaisse pas dans notre hiérarchie, nous montrerons qu´elle existe néanmoins.
En VA, il existe deux temps : le présent et le passé. Ces deux temps, dans la théorie minimaliste, existent sous forme de traits formels que possède la tête fonctionnelle T.
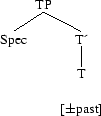
Ces traits sont satisfaits par des traits identiques qu´un verbe possède, comme l´illustre l´exemple suivant :
| Hwider | mæg | ic | nu | faran ? |
| Où | puis-IND.PRES | je-NOM | maintenant | aller ? |
Où puis-je aller maintenant ? (coapollo,ApT :12.9.198)
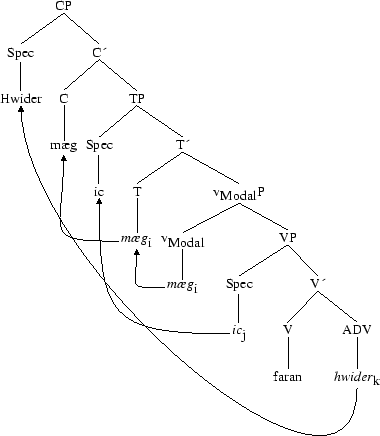
Dans cet exemple, nous savons que mæg est une forme présente grâce à sa morphologie : nous avons la voyelle radicale æ (à opposer à i qui marque la forme prétérit). Dès lors, ce verbe a le trait [-past] lorsqu´il est choisi dans le lexique, ainsi que le trait [+modal] inhérent aux verbes perfecto-présents. Le trait [+modal] est satisfait par un v qui possède ce même trait (c´est-à-dire vModal), quant au trait [-past], il est bien sûr satisfait par T. Nous avons alors :
MAGAN : voyelle radicale /-æ/, désinence ∅, marques du présent sg 1 et 3 (au pluriel voyelle radicale /-a/ et désinence /-on/)
vModal = [+modal], [-past]
T = [-past]
qui sous forme de structure donne (même s´il s´agit de Morphologie Distribuée, il nous semble plus clair de le représenter de la sorte) :
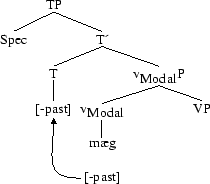
ou, selon la Morphologie Distribuée :
[T-V-Agr-sg2] ⟷ mæg [modal, présent, sg2]
C´est cette dernière forme qui est insérée dans la phrase.
A ce stade de la computation, mæg possède encore le trait [-past] (qui doit obligatoirement être satisfait). Ce trait va être satisfait avec celui de T. Et comme précédemment, lorsqu´il y a satisfaction des traits [-past] de T et vModal, ils sont effacés. A ce trait [-past], on peut ajouter le trait indicatif [-irréel]. Nous proposons qu´il existe une tête fonctionnelle Mode pour les formes subjonctives et que le mode [-irréel] est sous T pour les formes indicatives.
Prenons maintenant un exemple où il y a accord visible de la personne sur le verbe.
| Gif | ðu | wilt | mine | æðelborennesse | witan... |
| Si | tu-NOM | veux-IND.PRES. | ma-ACC | noblesse de naissance-ACC | connaître... |
Si tu veux connaître ma noble naissance... (coapollo,ApT :15.17.298)
Le verbe WILLAN se décompose de la sorte, au niveau du composant morphologique,
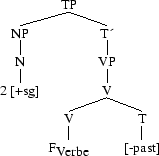
Si, maintenant, il y a satisfaction des traits ϕ du verbe avec le Spec de T, on obtient,
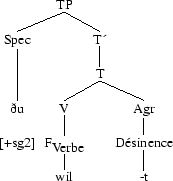
Lorsqu´il s´agit du prétérit, c´est encore la morphologie qui nous en indique la forme.
| ac | he | ne | mihte | hine | þar | findan | on | ðam | flocce. |
| mais | il-NOM | NEG | pouvait-PRET | lui-ACC | là | trouver | dans | les-DAT | troupes-DAT. |
mais il ne pouvait pas le trouver parmi les troupes. (coapollo,ApT :13.9.232)
Nous avons :
MAGAN : voyelle radicale /-i/, ainsi que la dentale finale /-t/, marques du prétérit ; de plus, nous avons une désinence ∅, qui nous informe que c´est un singulier (à opposer à /-on/ pour le pluriel).
En ce qui concerne le futur, il n´existe pas à proprement parler en VA (il en est de même en AC) : le locuteur utilise le présent, ou bien une périphrase utilisant les verbes WILLAN ou SCULAN au présent. Ainsi, il faudrait renommer la tête fonctionnelle T(Futur) dans la hiérarchie (161) et l´appeler T(Présent).
Au fil de notre analyse, nous avons remarqué que le VA possède deux modes : un mode indicatif, le réel, et un mode subjonctif, l´irréel. Cependant, bien que la morphologie du VA soit riche, bien des exemples sont ambigus : nous ne savons pas si nous avons affaire à un indicatif ou à un subjonctif, les désinences étant morphologiquement les mêmes. De plus, tous les perfecto-présents ne possèdent pas une forme subjonctive.
Dans la hiérarchie (161), nous avons remarqué l´existence d´une tête fonctionnelle pour le mode réel, qui est T, mais pas de tête fonctionnelle pour le mode irréel. Est-ce à dire que cette tête n´existe pas ? Nous venons de mentionner que le VA possédait effectivement un mode irréel. Les différents exemples de notre corpus illustrent effectivement l´existence d´une tête fonctionnelle irréelle, laquelle se situera plus haut que T. Dans la sphère irréelle, nous incluons, bien entendu, le subjonctif, mais aussi le conditionnel (note: ➳) (et plus loin dans notre travail l´épistémicité).
Les données du corpus VA nous indiquent la présence d´une tête fonctionnelle ModeIrréel dans notre hiérarchie (161) : il y a des formes indicatif, subjonctif et des formes ambiguës (on ne sait pas si, morphologiquement, ce sont des indicatifs ou des subjonctifs). De plus, le grand nombre de formes ambiguës trouvées annonce la fusion des formes indicatif et subjonctif en moyen-anglais.
Dans la sous-section précédente, nous avons souligné qu´il existait une tête fonctionnelle ModeRéel. Nous postulons deux têtes : une tête Mode [+irréel], et T sous laquelle se trouve le réel.
Reprenons l´exemple (168). Dans cette structure morphologique, nous avons fait apparaître la racine ainsi que la désinence. Cette dernière reflète tant le temps, la personne que le mode. Si l´on en donne maintenant la structure, nous avons (avec le verbe CUNNAN par exemple) :
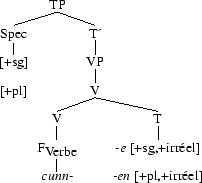
et si nous linéarisons ces éléments morphologiques, nous avons :
[T-V-sg] ⟷ cunne [modal,past,irréel,sg]
et
[T-V-pl] ⟷ cunnen [modal,past,irréel,pl]
La structure syntaxique correspondante est :
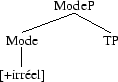
A cette structure, nous allons ajouter la tête T pour le mode réel.
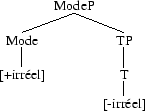
Illustrons maintenant nos propos concernant le subjonctif (exemples (175) à (177)) et l´indicatif (exemples (178) et (179)).
| ... | læf | folc | ond | rice, | þonne | ðu | forð | scyle | metodsceaft | seon. |
| ... | épargne-IMP | peuple-ACC | et | royaume-ACC, | alors que | tu-NOM | constamment | doives-SUBJ.PRES | destinée-ACC | considérer. |
... laisse à tes hommes le peuple et le royaume quand tu dois suivre sa destinée. (cobeowul,37.1176.971)
| ond | eac | swylce | leafnesse | sealde, | þæt | heo | mosten | Cristes | geleafan | bodian | & | læran. |
| et | aussi | de même | permission | donna-PRET, | que | ils-NOM | pussent-SUBJ.PRET | Christ-GEN | foi | prêcher | & | enseigner. |
et (il) donna aussi la permission pour qu´ils pussent prêcher et enseigner la foi du Christ. (cobede,Bede_1 :14.60.11.564)
| Ðæt | mæden | cwæð : | « Sege | me | gewislicor | þæt | ic | hit | mæge | understandan... » |
| La-NOM | jeune fille-NOM | dit-IND.PRET : | « dis-IMP | moi | clairement | que | je-NOM | cela-ACC | puisse-SUBJ.PRES | comprendre... » |
La jeune fille dit : « Dis-(le) moi clairement afin que je puisse le comprendre... » (coapollo,ApT :15.18.299)
| him | mid | scoldon | on | flodes | æht | feor | gewitan. |
| lui-DAT | avec | devaient-IND.PRET | sur | marée-GEN | pouvoir-ACC | d´ailleurs | aller. |
avec lui, (ils) devaient aller sur la puissance des flots. (cobeowul,4.36.36)
| Eac | neah | þan | ealle | þa | ðing, | þe ðanon | cumað, | wið | ælcum | attre | magon. |
| aussi | presque | les-INSTR | toutes-NOM | les-NOM | choses-NOM, | d´où que | viennent-IND.PRES, | contre | chaque-DAT | poison-DAT | peuvent-IND.PRES. |
presque toutes les choses (de cette île) sont bonnes contre le poison. (cobede,Bede_1 :1.30.3.225)
Afin d´illustrer notre analyse, donnons d´abord leur structure morphologique, sous la forme d´une arborescence, puis les structures syntaxiques des exemples (182.a) et (183.a).
La « structure » morphologique de (182.a) est alors,
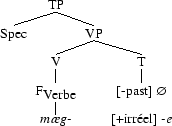
[T-irréel] ⟷ mæge [modal,présent,irréel,sg]
Quant à celle de (183.a), c´est,
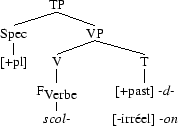
[T-réel-pl] ⟷ scoldon [modal,passé,réel,pl]
| Ðæt | mæden | cwæð : | « Sege | me | gewislicor | þæt | ic | hit | mæge | understandan... » |
| La-NOM | jeune fille-NOM | dit-IND.PRET : | « dis-IMP | moi | clairement | que | je-NOM | cela-ACC | puisse-SUBJ.PRES | comprendre... » |
La jeune fille dit : « Dis-(le) moi clairement que je puisse le comprendre... » (coapollo,ApT :15.18.299)
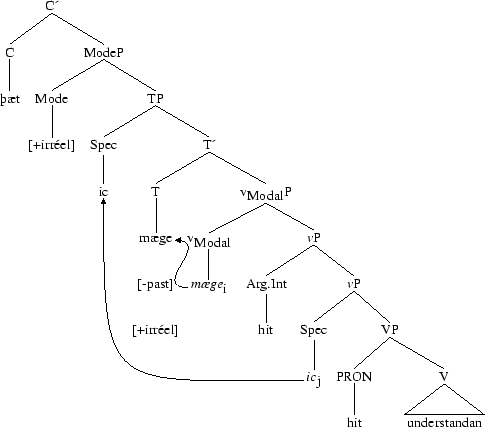
| him | mid | scoldon | on | flodes | æht | feor | gewitan. |
| lui-DAT | avec | devaient-IND.PRET | sur | marée-GEN | pouvoir-ACC | d´ailleurs | aller. |
avec lui, (ils) devaient aller sur la puissance des flots. (cobeowul,4.36.36)
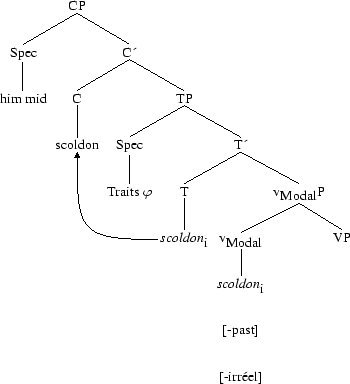
Laissons maintenant le subjonctif, et intéressons-nous au conditionnel, qui lui aussi appartient au domaine de l´irréel. Les textes du corpus nous montrent qu´il existe des structures introduites par gif si qui marque la condition. Les formes sur lesquelles nous allons nous arrêter sont les formes « conditionnelles » des perfecto-présents : trouve-t-on, dès le viel-anglais, des perfecto-présents ayant une forme morphologique passée avec une valeur de conditionnel ?
Sur l´ensemble des textes du corpus (Pintzuk, Leendert (2001) et Taylor, Warner, Pintzuk & Beth (2003)) du VA, nous avons trouvé les exemples suivants, où nous avons mis en italique gif (exemples (184) à (191)) ; dans les exemples (193) à (207), nous pensons que les formes morphologiques passées correspondent à des conditionnels au vu du contexte (notamment les temps) (note: ➳).
En anglais contemporain, une des structures pour une phrase conditionnelle est : if + temps passé + WOULD/SHOULD/COULD/ MIGHT/MUST, où les modaux appartiennent à la phrase matrice. Nous avons les structures suivantes en vieil-anglais :
if + Subj.Pres + CONDITIONNEL ,
| Gif | nu | hæleða | hwone | hlisan | lyste, | unnytne | gelp | agan | wille, | þonne | ic | hine | wolde | wordum | biddan | þæt | he | hine | æghwonon | utan | ymbeþohte, | ... |
| If | now | men-GEN | few-ACC | glory-GEN | please-SUBJ.PRES, | useless-ACC | help-ACC | have control over | will-PRES, | then | I-NOM | him-ACC | would-PRET | orders-DAT | ask | that | he-NOM | him-ACC | everywhere | from outside | thought about-PRET, | ... |
Si les hommes aiment un peu la gloire, ils contrôleront une aide inutile ; j´avais alors voulu lui demander qu´il songeât aux ordres en tout lieu, ... (cometboe,165.10.1.137)
if + Subj.Pret + CONDITIONNEL,
| ... | sua | hie | manegra | unðeawa | gestiran | meahton | mid | hiora | larum | & | bisenum, | gif | hi | ongemong | monnum | beon | wolden. |
| ... | as | they-NOM | many-GEN | faults-GEN | cause | could-IND.PRET | with | their | learnings-DAT | & | examples-DAT, | if | they-NOM | among | men-DAT | be | would-SUBJ.PRET. |
... comme ils auraient pu faire beaucoup de fautes de par leur éducation et de par leur exemple, s´ils avaient été parmi les hommes. (cocura,CP :5.45.20.257)
| Him | mon | sceal | cyðan | ðara | goda | sum | ðe | hie | on | him | habbað | oððe | ðara | sum | ðe | hie | habban | meahton, | gif | hie | næfden. |
| Him-DAT | one-NOM | shall-IND.PRES | prove | these-GEN | abilities-GEN | something-ACC | that | they-NOM | on | him-DAT | have-IND.PRES | or | these-GEN | ones-ACC | that | they-NOM | have | could-IND.PRET, | if | they-NOM | NEG+had-SUBJ.PRET. |
Ils doivent lui prouver les capacités qu´ils ont sur lui ou qu´ils pourraient avoir, s´ils ne les possédaient (déjà). (cocura,CP :41.303.2.2011)
if + Ind.Pres + CONDITIONNEL,
| Ðonne | mæg | he | witan | be | ðy, | gif | he | hierran | folgað | habban | sceal, | hwæðer | he | ðonne | don | mæg | ðæt | ðæt | he | ær | ðencð | ðæt | he | don | wolde, | ... |
| Then | can-IND.PRES | he-NOM | know | with | this-INSTR, | if | he-NOM | higher-ACC | destiny-ACC | have | shall-IND.PRES, | whether | he-NOM | then | do | can-IND.PRES | that-ACC | that | he-NOM | soon | attempts-IND.PRES | that | he-NOM | make | would-PRET, | ... |
Grâce à cela, il peut alors savoir s´il aura une destinée plus haute, s´il sera alors capable de le faire, ce qu´il essaierait et ferait bientôt, ... (cocura,CP :9.57.14.363)
| Hu | gerades | mæg | ðonne | se | biscep | brucan | ðære | hirdelican | are, | gif | he | self | drohtað | on | ðam | eorðlicum | tielongum | ðe | he | oðrum | monnum | lean | sceolde ? |
| How | long since | can-IND.PRES | then | the-NOM | bishop-NOM | cohabit with | this-DAT | domestic-GEN | desire-GEN, | if | he-NOM | self-NOM | behaves-IND.PRES | on | the-DAT | worldly-DAT | culture-DAT | that | he-NOM | other-DAT | men-DAT | blame | should-PRET ? |
Comment l´èvêque peut-il vivre avec ce désir, si lui-même agit selon la culture terrestre alors qu´il devrait blâmer les autres hommes ? (cocura,CP :18.133.3.909)
| Hu | bið | þonne | gif | we | nellað | to | þam | Hælende | clypian, | þonne | Moyses | werignyss | ne | mihte | beon | beladod ? |
| How | is-IND.PRES | then | if | we-NOM | NEG+will-IND.PRES | to | the-DAT | Lord-DAT | speak, | then | Moses-GEN | cursing-NOM | NEG | could-PRET | be | prevented-P.PASSE ? |
Comment cela peut-il alors être, si nous ne voulons pas parler au Seigneur, quand la malédiction de Moïse pourrait-elle être évitée ? (coaelive,ÆLS[Pr_Moses] : 43.2897)
| And | se | ðe | nele | Godes | bodan | hyran | mid | rihte | ne | godcundre | lare | gyman | swa | he | sceolde, | he | sceal | hyran | feondan, | gif | he | nele | freondan. |
| And | the | one-NOM who | NEG+will-PRES | God-GEN | foundation | serve | by | right-DAT | nor | religious-GEN | knowledge-GEN | observe | as | he-NOM | should-PRET, | he-NOM | shall-IND.PRES | obey | enemies-DAT, | if | he-NOM | NEG+will-PRES | friends-DAT. |
Et celui qui ne sert pas bien la fondation de Dieu, ni n´observe le savoir religieux comme il le devrait, celui-ci obéira aux ennemis s´il ne veut pas d´amis. (cowulf,WHom_17 :50.1398)
if + passé + CONDITIONNEL,
| & | þæt | mot | ure | gehwylc | rihtlice | healdan | gif | we | aht | gefaran | scylan ; |
| & | that-ACC | must-IND.PRES | ours-GEN | all-NOM | rightly | celebrate | if | we-NOM | possessions-ACC | obtain | should-IND.PRET ; |
Et nous devons tous (le) célébrer avec raison s´il faut que nous obtenions des biens ; (cowulf,WHom_18 :138.1503)
| ðonne | he | sceal | ymb | monigra | monna | are | ðencan, | gif | he | nolde | ða ða | he | moste | Pymb | his-GEN | anes. |
| then | he-NOM | shall-IND.PRES | about | many-GEN | men-GEN | freedom | consider, | if | he-NOM | NEG+would-PRET | when | he-NOM | must-PRET | about | his | only-GEN. |
et il considèrera alors l´honneur de nombreux hommes, même s´il ne le voulut pas quand il aurait pu le faire. (cocura,CP :9.57.19.365)
Avant d´analyser les autres exemples, regardons d´un peu plus près ceux que nous venons de donner. Si l´on s´en tient à ce que la grammaire contemporaine nous dit, les exemples (185), (192) et (186) contiennent un conditionnel. Dans les exemples (184), (187), (188), (189) et (190), le contexte nous permet de dire que nous avons aussi affaire à des conditionnels.
En ce qui concerne l´exemple (191), le schéma est inversé puisque le « conditionnel » est introduit par if. Cependant, c´est encore le contexte qui nous permet de dire que la forme introduite par if est un conditionnel.
Regardons maintenant le reste de nos exemples, dans lesquels les formes conditionnelles ne sont pas introduites par if, et voyons si ces formes sont effectivement des formes morphologiques passées à valeur de conditionnel (note: ➳).
| and | we | sceolon | his | gesetnyssum | gehyrsumian, | ðeah ðe | he | gyt | wolde | þas | niwan | gecyðnysse | eft | awendan, | ac | we | witon | þæt | he | nele. |
| and | we-NOM | should-IND.PRES | his-DAT | instructions-DAT | obey, | although | he-NOM | yet | would-PRET | this-ACC | newly-ACC | testimony-ACC | again | change, | but | we-NOM | know-IND.PRES | that | he-NOM | NEG+will-PRES. |
et nous devrions obéir à ses instructions, bien qu´il veuille encore changer sa récente déclaration, mais nous savons qu´il ne le fera pas. (cocathom2, ÆCHom_II,_12.2 :123.458.2703)
| ac | we | woldon | ærest | eow | gereccan | ymbe | ðas | gerynu | and | siððan | hu | hit | man | ðicgan | sceal. |
| but | we-NOM | would-IND.PRET | first | to you | explain | about | this-ACC | mystery-ACC | and | then | how | it-ACC | one-NOM | accept | shall-IND.PRES. |
mais d´abord on vous expliquerait tout de ce mystère et comment l´accepter. (cocathom2,ÆCHom_II,_15 :157.255.3503)
| Ic | mæg | fromlicor | fleogan | þonne | pernex | oþþe | earn | oþþe | hafoc | æfre | meahte ; |
| I-NOM | can-IND.PRES | faster | fly | than | bird-NOM | either | eagle-NOM | or | hawk-NOM | ever | could-PRET ; |
Je peux voler plus vite que l´oiseau, bien plus vite qu´un aigle ou un faucon ne le pourrait ; (coriddle,202.66.604)
| Ne | eft | ða | gelæredan, | ðe | sua | nyllað | libban | sua | hie | on | bocum | leornedon, | ðæt | hie | sceoldon | ne | underfon | ða | are | ðæs | lariowdomes. |
| nor | often | the-NOM | learnings-NOM, | that | so | will-IND.PRES | exist | so | they-NOM | inbooks-DAT | learnt-IND.PRET, | that | they-NOM | should-IND.PRET | NEG | accept | the-ACC | help-ACC | the-GEN | ecclesiastical authorities-GEN. |
et les savants qui ne veulent pas vivre comme ils l´ont appris dans les livres, et qui ne devraient pas accepter l´aide des autorités religieuses. (cocura,CPHead :9.2.3)
| ... | ðæt | se | sacerd | beran | sceolde | ðæs | domes | racu, | forðam | se | sacerd | scolde | & | git | sceal | simle | smealice | geðencean | ðæt | he | cunne | god | & | yfel | tosceadan, | ... |
| ... | that | the-NOM | priest-NOM | produce | should-PRET | these-GEN | judgments-GEN | explanation-NOM, | because | the-NOM | priest-NOM | should-PRET | & | yet | shall-IND.PRES | always | subtlely | attempt | that | he-NOM | can-SUBJ.PRES | good-ACC | & | evil-ACC | distinghish, | ... |
... de sorte que le prêtre doive avoir à expliquer ces lois, et toujours de manière subtile pour qu´il puisse distinguer le bien du mal, ... (cocura,CP :13.77.22.515)
| Forðam | bebiet | sio | halige | æ | ðæt | se | sacerd | scyle | onfon | ðone | suiðran | bogh | æt | ðære | offrunge, | & | se | sceolde | bion | asyndred | from | ðæm | odrum | flæsce. |
| Because | commands-IND.PRES | the-NOM | holy-NOM | rite-NOM | that | the-NOM | priest-NOM | shall-SUBJ.PRES | accept | the-ACC | more-ACC | offspring-ACC | from | the-DAT | sacrifice-DAT, | & | he-NOM | should-PRET | be | separated-P.PASSE | from | the-DAT | other-DAT | bodies-DAT. |
Car le rite saint ordonne que le prêtre accepte le plus de progéniture issue du sacrifice, et qu´elle devrait être séparée des autres corps. (cocura,CP :14.81.18.533)
| ... | ðæt | he | ne | mæge | ðurhteon | his | niehstum | ðæt | he | him | utan | don | scolde. |
| ... | that | he-NOM | NEG | can-SUBJ.PRES | undergo | his | neighbours-DAT | that | he-NOM | them-DAT | out | cause | should-PRET. |
... qu´il ne puisse plus supporter ses voisins de sorte qu´il devrait les mettre dehors. (cocura,CP :18.127.14.862)
| Monige | ðeah | nyllað | na | geðencean | ðæt | hi | beoð | oðrum | broðrum | ofergesett, | & | him | fore | bion | scoldon | on | godcundum | ðingum ; |
| Many-NOM | however | NEG+will-IND.PRES | not at all | think | that | they-NOM | are-IND.PRES | other-DAT | brothers-DAT | set over-P.PASSE, | & | them-DAT | for | be | should-IND.PRET | about | divine-DAT | things-DAT ; |
Néanmoins, beaucoup ne penseront, en aucun cas, qu´ils sont commandés par d´autres frères et que, pour eux, ils devraient appartenir aux choses divines ; (cocura,CP :18.127.16.863)
| Oððe | eft | (...) | se ðe | wile | forgiefan | ðæt | he | wrecan | sceolde, | to | ecum | witum | geteo | his | hieremenn. |
| And | often | (...) | who-NOM | will-PRES | forgive | that-ACC | he-NOM | banish | should-PRET, | to | eternal-DAT | knowledge-DAT | educate-SUBJ.PRES | his | serviteurs-ACC. |
Et souvent celui qui pardonnera ce qu´il devrait bannir éduque ses serviteurs au savoir éternel. (cocura,CP :20.149.21.1022)
| Forðæm | hit | ær | hit | nolde | behealdan | wið | unnyt | word, | hit | sceal | ðonne | niedinga | afeallan | for | ðæm | slide. |
| Because | it-NOM | soon | it-ACC | NEG+would-PRET | observe | with | useless-ACC | speech-ACC, | it-NOM | shall-IND.PRES | then | necessarily | demolish | for | this-DAT | fall-DAT. |
Car bientôt on ne l´examinerait pas avec un discours sans fondement, et cela devra tomber en décadence. (cocura,CP :38.279.4.1810)
| ... | him | hwæthwugu | wiðstent | ðæt | hi | ne | magon | swa | hrædlice | forðbrengan | ðæt | hi | tiohhiað | swa | hi | woldon. |
| ... | them-DAT | something-NOM | resist-IND.PRES | that | they-NOM | NEG | can-IND.PRES | so | soon | bring forth | that-ACC | they-NOM | determine-IND.PRES | that | they-NOM | would-IND.PRET. |
... et quelque chose leur résiste de sorte qu´ils ne peuvent réussir si rapidement ; ce qu´ils se détermineraient à faire. (cocura,CP :61.455.15.3278)
| ne | we | nellað | forberan | an | bysmorlic | word | for | ures | Drihtnes | naman, | swa | swa | we | don | sceoldon, | ... |
| nor | we-NOM | NEG+will-IND.PRES | tolerate | one-ACC | shameful-ACC | word-ACC | for | our-GEN | Lord-GEN | name, | so | that | we-NOM | do | should-IND.PRET, | ... |
ni nous ne tolèrerons de paroles honteuses envers notre Seigneur, comme nous devrions le faire, ... (coaelive,ÆLS[Maurice] :132.5758)
| forðam | we | nellað | Godes | lage | healdan | swa | swa | we | scoldan... |
| because | we-NOM | NEG+will-IND.PRES | God-GEN | rule | control | so | that | we-NOM | should-IND.PRET... |
car nous ne contrôlerons pas la loi de Dieu comme nous le devrions... (cowulf, WHom_3 :29.68)
| Ðonne | mæg | gecnawan | se | þe | ær | nolde | soðes | gelyfan | þæt | Crist | þurh | his | mægenþrym | þonne | geleanað | manna | gehwylcum | ærran | gewyrhta. |
| Then | can-IND.PRES | know | the | one-NOM who | before that | NEG+would-PRET | justice-GEN | grant | that | Christ-NOM | through | his | glory-ACC | then | rewards-IND.PRES | man-GEN | every-DAT. |
Alors, celui qui peut savoir n´aurait auparavant pas accepté de la justice que Jésus Christ récompense alors chaque homme de sa gloire. (cowulf,WHom_3 :63.84)
| & | nan | þing | gecnawað | mid | ænigean | gerade | þæs | ðe | eow | þearf | sy, | nu | ge | riht | nellað | habban | ne | healdan | on | eowran | heortan | swa | swa | ge | scoldan. |
| & | no-ACC | thing-ACC | know-IND | by | any-DAT | reckoning-DAT | this-GEN | that | you-DAT | necessity-NOM | is-SUBJ.PRES, | now | you-NOM | truth-ACC | NEG+will-IND.PRES | have | nor | possess | on | your | heart | so | as | you-NOM | should-IND.PRET. |
et (il) ne connaît rien de cette échéance qui vous est nécessaire, vous n´aurez ni ne possèderez la vérité conformément à vos cœurs ainsi que vous le devriez. (cowulf,WHom_11 :163.1084)
Nous pouvons dire que dans les exemples (193), (194), (196) à (198), (200), (202), et (204) à (206), les formes morphologiques passées des perfecto-présents ont effectivement une valeur de conditionnel ; en ce qui concerne les exemples (199), (203) et (207), ils nous paraissent ambigus, cependant, nous incluons ces formes dans la liste précédemment mentionnée (note: ➳).
Ces différentes occurrences nous permettent d´affirmer que le mode irréel existe bien en vieil-anglais, et que le tête fonctionnelle Mode est effectivement présente. Ainsi, selon les contextes bien entendu, les perfecto-présents pourront avoir le trait [+irréel].
Les formes morphologiquement passées peuvent dès lors avoir une valeur, et un sens, autre qu´un passé stricto sensus ; on peut dire qu´il y a un changement de statut, et grammaticalisation, à la période du vieil-anglais tardif.
Dans la structure (159), nous avons montré l´existence de trois têtes fonctionnelles modales : ModNecessity, ModVolitional et ModObligation, sous lesquelles étaient adjoints des adverbes de modalité. Ces têtes fonctionnelles laisseraient à penser que la modalité telle que nous pouvons la concevoir en AC existe déjà en VA. Dans la suite de notre travail, s´il n´y a pas lieu de spécifier, nous n´allons désormais parler que d´une seule tête fonctionnelle que nous allons définir (et qui accueille le mode, l´aspect et l´épistémicité en vieil-anglais tardif).
Nous ne pouvons pas être totalement sûrs que les perfecto-présents peuvent tous avoir une lecture modalisante, c´est-à-dire une lecture épistémique ou déontique. Il est vrai que certains d´entre eux peuvent avoir cette lecture (voir, par exemple Warner (1993) : 162 et suivantes). Ils sont avant tout, soit déontiques, soit épistémiques, et s´ils sont épistémiques, peut-être sont-il plus susceptibles d´être aussi déontiques.
Avant d´analyser quelques exemples, définissons ce qu´est la modalité épistémique et déontique (ou radicale).
On définit le terme épistémique de la manière suivante :
(...) the term `epistemic´ should apply not simply to modal systems that basically involve the notions of possibility and necessity, but to any modal system that indicates the degree of commitment by the speaker to what he says. (...) The use of this term may be wider than usual, but it seems completely justified etymologically since it is derived from the Greek word meaning `understanding´ or `knowledge´, and so is to be interpreted as showing the status of the speaker´s understanding or knowledge. (Palmer (1986) : 51) (note: ➳)
Quant au terme déontique, il est défini comme suit :
`Deontic´ is used in a wide sense here to include those types of modality that are characterized by Jespersen as `containing an element of will´. It is obvious, however, that the meanings associated with deontic modality are very different from those of epistemic modality. The latter is concerned with belief, knowlegde, truth, etc. in relation to the proposition, wheras the former is concerned with action, by others and by the speaker himself. (Palmer (1986 : 96)) (note: ➳)
Jusqu´à présent, nous avons vu que les perfecto-présents pouvaient apparaître dans deux types de contructions, où ils ont des statuts syntaxiques différents. Quand la structure syntaxique est Perf.Pres + NP, le perfecto-présent est un verbe lexical et il est généré sous V ; quand la structure est Perf.Pres + VP, c´est un verbe semi-lexical, et il est généré sous vModal. Quand le perfecto-présent est semi-lexical, il est, au vu de notre corpus, soit déontique, soit épistémique.
Venons-en maintenant à notre analyse. Dans un premier temps, nous avons pu remarqué que les perfecto-présents de notre corpus semblaient avoir une lecture déontique.
Regardons d´un peu plus près et attachons-nous à analyser certaines occurrences de *SCULAN (le perfecto-présent le plus à même d´avoir une lecture déontique), afin de voir si le processus de grammaticalisation a lieu. En effet, s´il y a ambiguïté pour des mêmes formes entre lecture épistémique et lecture déontique, c´est le signe d´une grammaticalisation : le modal est soit dans la portée du temps de la phrase, et il a une lecture déontique (et il est plus bas que T, c´est-à-dire vModal), soit le modal est hors de la portée du temps (et il est plus haut que T, c´est-à-dire Mode).
Les occurrences que nous proposons maintenant ont toutes une lecture déontique.
| Ic | þe | sceal | mine | gelæstan | freode. |
| je-NOM | celui-DAT | dois-IND.PRES | mon-ACC | aider | ami-ACC. |
Je m´acquitterai de mon amitié envers toi. (cobeowul,52.1706.1409)
| sceal | hringnaca | ofer | heafu | bringan | lac | ond | luftacen. |
| doit-IND.PRES | vaisseau-NOM | de l´autre côté | mers-ACC | amener | offrandes-ACC | et | preuves d´amour-ACC. |
LE vaisseau apportera des présents et des gages d´amitié au-delà des mers. (cobeowul,57.1855.1534)
| ... | hu | he | in | Godes | huse | drohtian | & | don | scolde. |
| ... | comment | il-NOM | dans | Dieu-GEN | maison-DAT | se comporter | et | agir | devait-PRET. |
... comment il devait se comporter et agir dans la maison de Dieu. (cobede, Bede_1 :16.64.10.601)
| ic | sceal | hraðe | deað | underhnigan. |
| je-NOM | dois-IND.PRES | immédiatement | mort-ACC | subir. |
je dois mourir immédiatement. (cobede,Bede_3 :11.190.16.1920)
| Hwæt | sculon | we | nu | þæs | mare | sprecan ? |
| Que | devons-IND.PRES | nous-NOM | maintenant | cela-GEN | plus-ACC | parler ? |
De quoi devons-nous parler en plus de cela ? (cobede,Bede_3 :19.244.10.2502)
| and | gif | ðu | þæt | ne | dest | þu | scealt | oncnawan | þone | gesettan | dom. |
| et | si | tu-NOM | cela-ACC | NEG | fais-IND.PRES | tu-NOM | dois-IND.PRES | connaître | le-ACC | établi-ACC | jugement-ACC. |
et si tu ne le fais pas, tu dois connaître le jugement établi. (coapollo,ApT :5.5.71)
| ... | þæt | he | scolde | Appolonium | acwellan. |
| ... | que | il-NOM | devait-PRET | Appolonius-ACC | tuer. |
... qu´il devait tuer Appolonius. (coapollo,ApT :7.7.99)
| þa | wende | he | ærest | þæt | hine | man | scolde | ofslean. |
| alors | crut-IND.PRET | il-NOM | d´abord | que | lui-ACC | on-NOM | devait-PRET | tuer. |
Il crut d´abord qu´on devait le tuer. (coapollo,ApT :51.12.569)
La structure des modaux déontiques est la suivante :
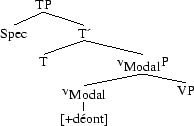
Cette lecture est encore très minoritaire en VA, mais elle se généralise au cours de l´histoire de l´anglais (ce que nous allons voir dans les chapitres suivants). Les exemples de perfecto-présents ayant une lecture épistémique sont tirés de Denison (1993) : 298-303.
Les exemples (217) à (225) ont un sujet réalisé,
| And | hi | ða | ealle | sæton, | swa swa | mihte | beon | fif | ðusend | wera. |
| Et | ils-NOM | alors | tous | s´assirent-IND.PRET, | comme | pouvaient | être | cinq | mille | hommes. |
Et, alors, ils étaient tous assis, peut-être étaient-ils cinq mille hommes. (ÆCHom I 12.182.15 ; 950-1050.)
| Sume | beladunge | mihte | se | rica | habban | his | uncyste, | gif | se | reoflia | wædla | ne | læge | ætforan | his | gesihðe... |
| Quelque | excuse-ACC | pouvait-IND.PRET | le | homme riche-NOM | avoir | sa | radinerie-DAT, | si | le | lépreux | mendiant-NOM | NEG | mette-SUBJ | devant | sa | vue... |
L´homme riche aurait pu avoir quelque excuse pour sa radinerie si le mendiant lépreux ne s´etait pas placé devant ses yeux... (ÆCHom I 23.330.9 ; 950-1050.)
| Wel | þæt | swa | mæg. |
| Bien | cela-NOM | ainsi | peut. |
Cela peut bien en être ainsi. (Bede 2 1.96.23 ; 850-950.)
| Ðuhte | him | on mode | þæt | hit | mihte | swa, | þæt | hie | weron | seolfe | swegles | brytan, | ... |
| Semblait | eux-DAT | en toute conscience | que | cela-NOM | pouvait | de sorte, | que | ils | étaient | mêmes | cieux-GEN | gouverner, | ... |
Il leur semblait qu´il se pourrait bien qu´ils gouvernent eux-mêmes les cieux, ... (Sat 22 ; Xe s.)
| Swiþe | eaþe | þæt | mæg-PRES | beon | þæt | sume | men | þencan... |
| Très | bien | cela-GEN | peut | être | que | certains | hommes | pensent... |
Il se peut très bien que certains hommes pensent... (BlHom 21.17 ; 950-1050.)
| ðu-NOM | scealt-PRES | deaðe | sweltan. |
| tu | dois | sûrement | mourir. |
tu mourras très certainement. (Gen 2.17 ; 950-1050.)
| Wende | ic | þæt | þu | þy | wærra | weorþan | sceolde... |
| pensais | je | que | tu-NOM | le | plus conscience | devenir | devait... |
Je pensais que tu prendrais conscience... (Jul 425 ; 950-1050)
| wen | is, | þæt | hi | us | lifigende | lungre | wyllen | sniome | forsweolgan. |
| espérance | est, | que | ils-NOM | nous | vivant | rapidement | veulent-SUBJ.PRES | immédiatement | engloutir |
Il est vraisemblable qu´ils vont nous engloutir immédiatement. (Jul 123.2 ; 950-1050.)
| eastewerd | hit | mæg | bion | syxtig | mila | brade | oþþe | hwene | bræde. |
| vers l´est | cela-NOM | peut-PRES | être | soixante | miles | large | ou | un petit peu | plus large. |
vers l´est, cela peut être large de soixantes miles, ou un peu plus. (Or 15.26 ; 850-950.)
les exemples (226) à (238) n´en ont pas,
| Mæg | þæs | þonne | ofþyncan | ðeodne | Heaðobeardna | ond | þegna | gehwam | þara | leoda, | þonne | he... |
| Peut-PRES | cela-GEN | alors | regretter | seigneur-DAT | Heathobards-GEN | et | vassaux-GEN | chaque | le | peuple-GEN, | quand | il... |
Il se peut que le seigneur de Heathobards et que chaque gentilhomme du peuple le regrettent quand il... (Beo 2032 ; 950-1050.)
| Nu | mæg | eaþe | getimian, | þæt | eower | sum | ahsige, | hwi... |
| Maintenant | peut | bien | arriver, | que | vous-GEN | quelque | demander, | pourquoi... |
Il se peut fort bien que l´un d´entre vous demande maintenant pourquoi... (ÆLet2 (Wulstan 1)147 122.11 ; 950-1050.)
| [Me | mæig]... | & | raðe | æfter | ðam, | gif | hit | mot | gewiderian, | mederan | settan... |
| [On | peut]... | & | rapidement | après | cela, | si | cela | peut | être beau temps, | garance | plantez... |
... et tout de suite après, si le temps le permet, plantez de la garance... (LawGer 12 454 ; Xe-XIe s.)
| Ic | axige | hwæðer | hit | mihte | gedafenian | abrahame | þam | halgan | were... |
| Je | me demande | si | cela | pourrait | aller à | Abraham | le | saint | homme... |
Je demande si cela aurait pu convenir à Abraham, le saint homme... (ÆIntSig 61 400 ; 950-1050.)
| Þon | mag | hine | scamigan | þære | brædinge | his | hlisan. |
| Alors | peut | lui-ACC | avoir honte | la | étendue | sa | gloire. |
il se peut alors qu´il ait honte de l´étendue de sa gloire. (Bo 46.5 ; 950-1050.)
| Hu | wolde | þe | nu | lician | gif... |
| Comment | vouloir-COND | toi-DAT | maintenant | faire plaisir | si... |
Comment voudrais-tu que cela te plaise maintenant si... (Bo 142.2 ; 950-1050.)
| ... | þæt | we | þa | þing | don | þe | us | to | ecere | hælu | gelimpan | mote. |
| ... | que | nous | ces | choses | faisons-PRES | qui | nous-DAT | pour | salut | éternel | arriver | peut. |
... que nous fassions ces choses qui peuvent mener à notre salut éternel. (HomS 25 412 ; 950-1050.)
| ... | ðæt | us | ne | ðurfe | sceamian. |
| ... | que | nous-DAT | NEG | a besoin | honte. |
... que nous n´avons pas besoin de ressentir de la honte. (HomM 5(Willard) 57.6 ; Xe s.)
| ... | hine | sceal | on domes dæg | gesceamian | beforan | gode | ... | swa | þam | men | dyde, | þe... |
| ... | lui-ACC | doit | jour du jugement | avoir honte | devant | Dieu | ... | comme | cet | homme-DAT | fit, | qui... |
... le jour du jugement, il ressentira la honte devant Dieu... comme l´a ressentie cet homme qui... (HomU 37(Nap 46) 238.12 ; 950-1050.)
| ... | ne | him | hingrian | ne | mæg... |
| ... | ni | lui-DAT | avoir faim | NEG | peut... |
... ni ne peut-il avoir faim... (ÆHom I 2.235.112 ; 950-1050.)
| ... | þonne | sceal | þe | spowan | & | þe | bet | limpan. |
| ... | alors | FUTUR | toi | prospérer | & | le | mieux | arriver. |
... alors tu prospèreras et tout ira pour le mieux pour toi. (HomU 14(Holt) 4 ; 950-1050.)
| Ac | se | þe | geð | into | fihte | wið-ute | heretoche. | him | mai | sone | mislimpe. |
| Mais | celui | qui | va | dans | combat | sans | chef. | lui-DAT | peut | bientôt | aller mal à propos. |
Mais celui qui va au combat sans chef pourrait bientôt devenir un métayer. (1175 Lamb.Hom 243.18 ; 950-1050)
| Eaðe | mæg | gewurðan | þæt | þu | wite | þæt | ic | nat, | ðu | þe | þer | andweard | wære. |
| Fort bien | peut-PRES | être | que | tu-NOM | connaisses-SUBJ.PRES | que | je-NOM | NEG+connais-IND.PRES, | toi-NOM | qui-NOM | là | présent-P.PASSE | était-IND.PRET. |
Il se peut fort bien que tu saches ce que je ne sais pas, toi qui étais présent. (Warner (1993) : 166 ; Apollonius of Tyre, 950-1050.)
Ces perfecto-présents épistémiques, bien que peu nombreux, impliquent un processus de grammaticalisation dès la première partie de la période du vieil-anglais tardif, ce qui correspond aux Xe-XIe siècles. Ainsi :
Ces structures sont des structures de montée ; le cas NOM est assigné par T.
Si ce sont des verbes épistémiques, et des verbes de montée, ils sont générés sous T et gouvernés par une position plus haute que nous pensons être Mode ([ModeP - TP - VP]).
Donc, dès le VA tardif, il y aurait une position syntaxique pour ces verbes épistémiques. Mais quelle est-elle ?
Avant de répondre à cette question, nous allons nous intéresser à la notion d´aspect perfectif, et souligner le lien qui existe entre épistémicité et aspect d´un point de vue syntaxique, ce qui nous permet de motiver que la position Mode accueille tant l´aspect que l´épistémicité.
Dans cette section, nous allons relier aspect perfectif et épistémicité. Et nous émettons l´hypothèse suivante : l´apparition de certains modaux épistémiques serait à mettre en parallèle avec l´emploi de plus en plus rare de l´aspect à la période du vieil-anglais tardif. Regardons la structure HAVE + EN. L´emploi de cette forme est assez important en VA primitif, mais beaucoup moins en VA tardif, période à laquelle les premiers épistémiques apparaissent.
Ces premiers modaux épistémiques, ainsi que l´usage plus rare de l´aspect perfectif motiverait la position syntaxique Mode qui accueillerait tant l´épistémicité que l´aspect (en plus du mode [+irréel]). En effet, ces deux notions ont en commun le fait que l´énonciateur commente l´événement, donne son point de vue, fait part de son savoir, et ce, après que la relation sujet-prédicat a été mise en place (dans le domaine de C).
Nous avons donc regardé les occurrences de l´aspect perfectif dans notre corpus, et plus précisément les exemples dans lesquels le participe passé suit directement HAVE (afin de ne pas le confondre avec le have événementiel). Sur l´ensemble du corpus VA (Pintzuk, Leendert (2001) et Taylor, Warner, Pintzuk, Beths (2003)) et , nous n´avons trouvé que très peu d´exemples (731 sur 119062 occurrences), et ceux que nous avons trouvés vont, dans leur très grande majorité, jusqu´au Xe-XIe siècles. Mais à partir de cette période, et jusqu´à la fin de la période vieil-anglaise, ces structures se font beaucoup plus rares. Elles n´apparaissent quasiment plus dans le corpus sensiblement au même moment de l´émergence de la lecture épistémique de certains perfecto-présents (comme nous allons le voir plus loin). Cela impliquerait que l´aspect (perfectif) est dans un premier temps sous T, mais qu´avec la courbe descendante de l´emploi de la structure HAVE + EN à la fin de la période VA, il se trouve plus haut dans la structure (c´est-à-dire au-dessus de T, dans le domaine de CP, dans le domaine d´interprétation des perfecto-présents épistémiques), sous Mode. Regardons quelques exemples.
| We | habbad | nu | gesæd | sceortlice | on | Englisc | þis | halige | godspell... |
| Nous-NOM | avons-IND.PRES | maintenant | expliqué-P.PASSE | brièvement | en | anglais | ce | saint | évangile... |
Dès lors, nous avons brièvement expliqué en anglais ce saint évangile... (coaelhom,ÆHom_8 :50.1194)
| & | se | cyng | hæfde | gegadrod | sum | hund | scipa. |
| & | le-NOM | roi-NOM | avait-PRET | assemblé-P.PASSE | quelques-ACC | centaines | bateaux-GEN. |
& le roi avait rassemblé quelques centaines de bateaux. (cochronA-2b, ChronA_[Plummer] :911.3.1205))
| Ge | wel | habbad | geworht... |
| Vous | bien | avez-IND.PRES | travaillé... |
Vous avez bien travaillé... (cogregdC,GDPref_and_3_[C] :14.202.6.2631)
| Darius | hæfde | gebunden | his | agene | mægas | mid | gyldenre | racentan. |
| Darius-ACC | avait-PRET | attaché-P.PASSE | son | propre-NOM | parent-NOM | avec | en or | chaîne. |
Le propre père de Darius l´avait attaché à l´aide d´une chaîne en or. (coorosiu,Or_3 :9.70.7.1374)
Nous nous sommes aussi intéressés à la structure MD + HAVE + EN. Sur l´ensemble du corpus, tous textes confondus, nous n´avons trouvé que quatre occurrences. Elles datent toutes d´une période allant du Xe au XIIe siècles. On peut donc avancer que ces perfecto-présents, dans ces exemples particuliers, ont une lecture épistémisque. Quant à l´aspect, il n´est plus à mettre sur le même plan syntaxique que les modaux puisque c´est lui qui désormais va « porter » le temps : il indique si l´événement se situe dans le présent ou le passé. Dans le cas de la structure MD + HAVE + EN, la sphère temporelle est passée (comme le montre l´anglais contemporain).
Illustrons notre propos, et donnons les exemples que nous avons trouvés (il est intéressant de remarquer que toutes les structures que nous avons trouvées comportent WILLAN) :
| hu | micelan | woldest | þu | þa | habban | geboht | þæt | ðu | switole | mihtest | tocnawan | þine | frind | & | ðine | fynd... |
| how | many | would-IND.PRET | you-NOM | then | have | paid for-P.PASSE | that | you-NOM | precisely | might-IND.PRET | recognise | your-ACC | friend-ACC | and | your-ACC | enemy-ACC... |
combien aurais-tu payé pour reconnaître ton ami de ton ennemi... (coboeth,Bo :20. 48.14.868)
| hu | micle | feo | woldest | þu | nu | habban | geboht | þæt | þu | meahte | ongitan | hwæt | þæt | soðe | god | wære... |
| how | much | money | would-IND.PRET | you-NOM | now | have | paid for-P.PASSE | that | you-NOM | might-SUBJ.PRET | understand | what-NOM | that-NOM | true-NOM | god-NOM | were-SUBJ.PRET... |
combien aurais-tu payé pour que tu pus comprendre ce que le vrai dieu était vraiment... (coboeth,Bo :34.89.26.1712)
| hæo | wile | habban | gefadad | hiræ | æhta | for | Gode | & | for worldæ... |
| they-NOM | will-PRES | have | granted-P.PASSE | their | possessions-ACC | for | God-DAT | & | as regards this world... |
ils auront accordé leurs biens à Dieu et au monde... (codocu3,Ch_1486_ [Whitelock_15] :1.282)
| he | wolde | habban | forsuwod | þæt, | þæt | na | forholen | beon | ne | mihte. |
| he-NOM | would-PRET | have | silenced-P.PASSE | that-ACC, | that-NOM | not at all | concealed-P.PASSE | be | NEG | might-PRET. |
il l´aurait passé sous silence, mais cela ne pouvait absolument pas être tû. (cogregdH,GD_1_[H] :9.60.13.577)
Si l´on illustre ce dernier exemple, nous aurions la structure suivante (où l´aspect perfectif n´est plus sous T (rempli par le modal) mais en-dessous de T) :
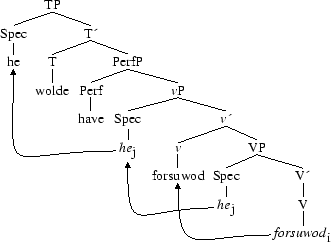
Revenons maintenant aux perfecto-présents. Les exemples (231) à (238) illustrent la lecture épistémique que l´on peut faire des perfecto-présents (le temps de l´évaluation de la relation prédicative est le temps de l´énonciation, et non le temps lié à l´événement, comme nous venons de le voir avec l´aspect) . Si cette lecture est possible en VA, cela implique qu´il existe un domaine d´interprétation qui est lié au temps de l´énonciation, et qui possède un trait [-déont]. Cependant, une question se pose : est-ce qu´un perfecto-présent ayant une lecture épistémique est nécessairement un verbe de montée ? S´il a une lecture épistémique, il est effectivement un verbe de montée, et dès lors, la lecture épistémique est déterminée par une position syntaxique plus haute dans la structure, c´est-à-dire au-dessus de T, dans le domaine interprétatif de CP. Cela implique alors que, dès la période du vieil-anglais tardif, il existe deux positions pour les perfecto-présents : une position vModal lorsque ces derniers sont déontiques, une position Mode lorsqu´ils ont une lecture épistémique. Nous avons donc une structure de ce type en VA tardif :
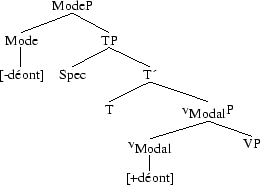
Si l´on se réfère à nouveau à la structure hiérarchique de Cinque (161), on peut remarquer que la tête fonctionnelle ModObligation existe, mais pas la tête ModPossibilité. En d´autres termes, il y a une tête Mod qui a un trait [+obligation] (c´est-à-dire un trait [+déont]), mais elle ne semble pas encore posséder de trait [-déont]. Les exemples (231) à (238) laissent à penser que cette dernière est effectivement présente en VA. Si l´on se réfère maintenant à Cinque (1999), nous nous rendons compte que celui-ci postule une tête fonctionnelle modale supplémentaire : ModEpistémique, dont le Spec serait un adverbe du type probablement. A la différence de Cinque, nous préférons considérer qu´il y a une seule tête fonctionnelle Mode, qui possède le trait [-déont], et une tête fonctionnelle vModal qui possède le trait [+déont], ou pour rendre mieux compte du processus de grammaticalisation, le modal aurait un trait [±déont], selon la lecture que l´on en fait.
Dans les exemples que nous avons choisis avec *SCULAN, la notion de devoir et d´obligation sont présentes (c´est le cas dans tous les exemples de ce type dans le corpus). Les exemples (208) à (215) ont tous des lectures déontiques : l´obligation est forte, soit de la part du locuteur, soit de la part d´une tierce personne. Quant aux exemples (231) à (238), ils ont tous une lecture épistémique, ce qui nous permet d´introduire un trait [-déont] à la tête fonctionnelle Mode.
Si nous récapitulons ce qui vient d´être dit, nous avons la structure suivante :
[Mode ([-déont]) [T [vModal ([+déont])]]].
Nous émettons alors les hypothèses suivantes : chaque perfecto-présent possède un trait [+modal], c´est-à-dire [±déont], selon la lecture du perfecto-présent. Ces traits sont satisfaits à distance par les têtes fonctionnelles correspondantes. Le perfecto-présent sera généré sous vModal puis il fusionnera à T, après avoir satisfait son trait de temps et ses traits ϕ (avec Spec,TP). Une fois sous T, toute autre satisfaction de traits ([±déont]) se fera à distance, sans qu´il y ait mouvement du perfecto-présent (c´est-à-dire que la tête fonctionnelle Mod va gouverner T (comme avec l´Affix Hopping en anglais contemporain)).
Prenons maintenant deux exemples parmi ceux que nous venons de proposer : une lecture épistémique (223), maintenant (249.a), et une lecture déontique (214), maintenant (250.a), et illustrons notre propos d´une structure pour chacun d´entre eux.
| Geleafan | heo | hæfde | (...) | þæt | Drihten | mihte | hire | aweddan | dohtor | gehælan. |
| Croyance | elle-NOM | avait-PRET | (...) | que | Seigneur-NOM | pouvait-PRET | sa | devenue folle-ACC | fille-ACC | guérir. |
Elle croyait que le Seigneur aurait pu guérir sa fille de la folie. (cocathom2, ÆCHom_II,_8 :69.83.1406)
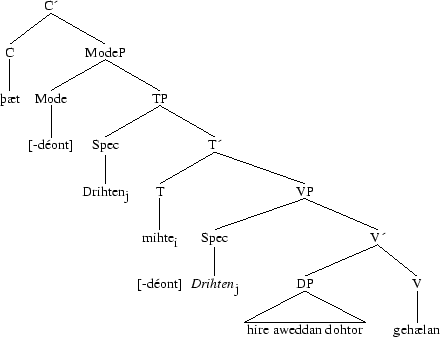
| ... | þæt | he | scolde | Appolonium | acwellan. |
| ... | que | il-NOM | devait-PRET | Appolonius-ACC | tuer. |
... qu´il devait tuer Appolonius. (coapollo,ApT :7.7.99)
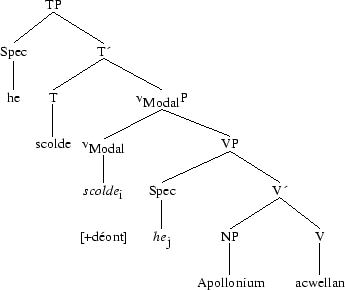
Nous n´avons pris que deux exemples, mais ces structures vaudraient pour toutes les autres occurrences. Quand les perfecto-présents ont une lecture épistémique, ce sont des verbes de montée. Analysons-les de plus près.
On appelle verbe de montée, un verbe qui n´assigne pas de θ-rôle externe. C´est le sujet du verbe non fini qui devient le sujet du verbe de montée, en Spec,TP. Ce sont, par exemple, les verbes seem ou appear en anglais contemporain (Johni seems ti to be happy).
Pour les perfecto-présents ayant une lecture épistémique, la structure serait identique.
Rappelons néanmoins ce qu´est un verbe de contrôle. C´est un verbe qui prend comme complément une infinitive laquelle possède un sujet PRO (qui est contrôlé par le sujet ou le COD du verbe fini). Un exemple est le verbe want (Johni wants [PROi to be happy]).
Dans la littérature concernant la syntaxe, les verbes épistémiques sont des verbes de montée. Regardons si tel est le cas dans notre corpus. Mais avant cela, nous allons nous intéresser au verbe ðyncan (l´ancêtre des verbes « seem » et « appear ») qui, dès le VA, est un verbe de montée. Nous allons ensuite essayer de faire un parallèle avec les perfecto-présents (épistémiques et déontiques) afin de voir si ce sont aussi des verbes de montée.
Avant d´analyser ðyncan, rappelons les structures des verbes de montée en anglais contemporain, avec les exemples suivants :
It seems that he understands her.
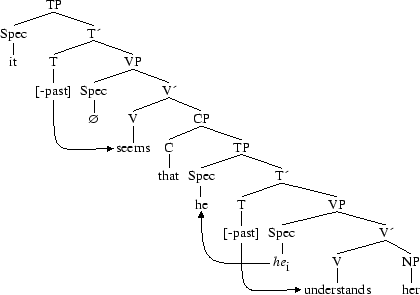
He seems to understand her.
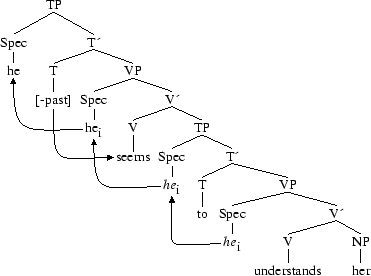
Dans le corpus VA Pintzuk, Leendert (2001) et (Taylor, Warner, Pintzuk, Beths (2003) , nous avons trouvé des occurrences du verbe ðyncan, avec des structures identiques à celles que nous pouvons trouver en anglais contemporain :
suivi d´une phrase enchâssée (CP) finie, et le sujet est un explétif (nous garderons la notation du corpus *exp*, qui marque une catégorie vide),
| *exp* | þa | ðuhte | him | nyttre | & | betre, | þæt | he | ðær | Godes | word | bodade | & | lærde, | ... |
| (explétif) | alors | sembla-PRET | lui-DAT | utile-NOM | & | meilleur-NOM, | que | il-NOM | là | Dieu-GEN | parole-ACC | annonçât-PRET | & | enseignât-PRET, | ... |
Cela lui sembla alors mieux et plus utile qu´il annonçât et enseignât la parole de Dieu dès ce moment, ... (cobede,Bede_3 :5.166.28.1613)
| *exp* | Ne | ðuhte | him | to | huxlic, | þæt | he | mid | gesceade | hine | betealde | unsynninne, | ... |
| (explétif) | NEG | semblait-PRET | lui-DAT | en outre | ignomineux-NOM, | que | il-NOM | avec | raison-DAT | lui-même-ACC | opprima-PRET | innocent-ACC, | ... |
En outre, il ne lui semblait pas honteux qu´il opprimât de manière juste l´innocent, ... (cocathom2,ÆCHom_II,_13 :128.45.2817)
| *exp* | Ne | ðynce | him | no | genog | ðæt | he | ana | wel | libbe, | ... |
| (explétif) | NEG | semble-SUBJ.PRES | lui-DAT | nullement | suffisant-NOM | que | il-NOM | seul | bien | vive-SUBJ.PRES, | ... |
Cela ne lui semble en aucun cas suffisant qu´il vive bien seul, ... (cocura, CP :28.193.22.1295)
| & | *exp* | þuhte | þæt | hit | eal | forbyrnan | sceolde. |
| & | (explétif) | apparut-PRET | que | cela-NOM | tout | brûler | devait-PRET. |
il apparut que tout devait brûler. (coblick,LS_17.1_[MartinMor [BlHom_17]] :221.172.2822)
il peut être suivi d´un TP introduit par TO,
| Ðara | byrðenna | hefignesse, | eall | ðæt | ic | his | geman, | ic | awrite | on | ðisse | andweardan | bec, | ðylæs | hi | hwæm | leohte | ðyncen | to | underfonne. |
| Ces-GEN | fardeaux-GEN | lourdeur, | tout-ACC | cela-ACC | je-NOM | sien-GEN | me souviens-IND.PRES, | je-NOM | écris-PRES | sur | ce-DAT | présent-DAT | livre-DAT, | de peur que | ils-NOM | qui-INSTR | légers-NOM | semblent-SUBJ.PRES | TO | accepter. |
Je me souviens du poids de ces fardeaux, je l´écris à présent sur ce livre de peur qu´ils ne paraissent légers à accepter. (cocura,CP :0.23.11.71)
| hit | ne | þuhte | æðryt | to | awritenne. |
| cela-NOM | NEG | semblait-PRET | fatiguant-NOM | TO | transcrire-DAT. |
Transcrire ne paraissait pas fatiguant. (cotempo,ÆTemp :10.22.342)
| ... | ðylæs | hi | hwæm | leohte | ðyncen | to | underfonne. |
| ... | de peur que | ils-NOM | celui-INSTR | rapides | semblent-SUBJ.PRES | TO | accepter-DAT. |
... de peur qu´ils semblent prompts à l´accepter de sa part. (cocura,CP :0.23.11.71)
La structure de cet exemple est,
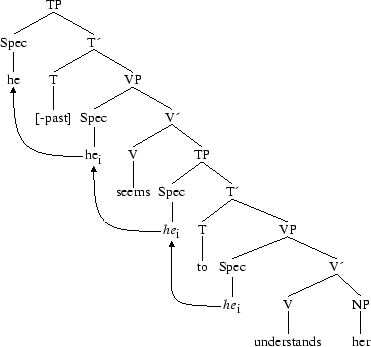
Dans les exemples (253) à (255), le sujet du verbe ÐYNCAN est un pronom explétif. Dans l´exemple (257), le sujet du verbe ÐYNCAN est monté : il était en position sujet de la proposition infinitive. Le sujet du verbe ÐYNCAN est marqué au cas nominatif, mais il suit le même schéma que dans les autres exemples : il est généré sous Spec,vP, et monte à Spec,TP pour que la dérivation n´échoue pas ; il satisfait alors les traits ϕ de Spec,TP.
| *exp* | þa | ðuhte | him | nyttre | & | betre, | þæt | he | ðær | Godes | word | bodade | & | lærde... |
| (explétif) | alors | sembla-PRET | lui-DAT | utile-NOM | & | meilleur-NOM, | que | il-NOM | là | Dieu-GEN | parole-ACC | annonçât-PRET | & | enseignât-PRET... |
Cela lui sembla alors mieux et plus utile, de sorte qu´il annonçât et enseignât la parole de Dieu dès ce moment... (cobede,Bede_3 :5.166.28.1607)
La structure de ce dernier exemple est,
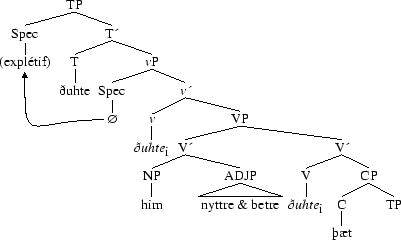
Dans cet exemple, le seul sujet de la phrase est un pronom explétif, qui n´est pas visible, mais qui est syntaxique. Alors que dans l´exemple qui suit, le sujet est visible,
| ... | ðylæs | hi | hwæm | leohte | ðyncen | to | underfonne. |
| ... | de peur que | ils-NOM | qui-INSTR | rapides-NOM | semblent-SUBJ.PRES | TO | accepter. |
... de peur qu´ils ne semblent prompts à l´accepter de sa part. (cocura,CP :0.23.11.71)
Et la structure de cet exemple est,
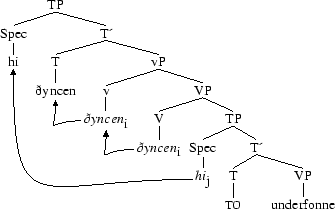
Le sujet hi monte en Spec,TP pour satisfaire les traits ϕ de T, d´où la marque du cas nominatif.
Les exemples ci-dessus illustrent ce qu´est un verbe de montée. Si maintenant, nous prenons un perfecto-présent ayant une lecture épistémique, nous nous attendons à ce que celui-ci ait la même structure avec un sujet explétif, ou un sujet qui est monté de Spec,vP à Spec,TP. Regardons maintenant si le fonctionnement des verbes perfecto-présents épistémiques est identique à celui de ÐYNCAN dans les exemples que nous venons de mentionner.
Reprenons notre exemple (249.a), et analysons plus précisément sa structure (par rapport à celle que nous avons proposée précédemment).
| Geleafan | heo | hæfde | (...) | þæt | Drihten | mihte | hire | aweddan | dohtor | gehælan. |
| Croyance | elle-NOM | avait-PRET | (...) | que | Seigneur-NOM | pouvait-PRET | sa | devenue folle-ACC | fille-ACC | guérir. |
Elle croyait que le Seigneur aurait pu guérir sa fille de la folie. (cathom2, ÆCHom_II,_8 :69.83.1406)
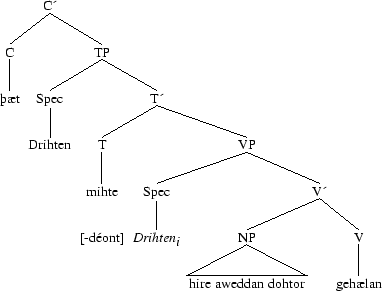
S´il y a lecture épistémique de certains perfecto-présents, dans des contextes définis, et que dans d´autres contextes, ils ont une lecture déontique, nous pourrions penser que les perfecto-présents déontiques sont aussi des verbes de montée (le sujet grammatical est le sujet sémantique du verbe non fini). C´est l´hypothèse que nous faisons et que nous allons analyser dans le prochain chapitre.
Dans la Section 2.2, nous avons présenté la classe des verbes que sont les perfecto-présents, et qui comptent dans leurs rangs la grande majorité des verbes modaux de l´anglais contemporain.
Dans la Section 2.3, nous avons montré l´existence de certaines têtes fonctionnelles – C, T et v – à la lumière des nouvelles hypothèses de travail de Chomsky : les phases. Nous avons aussi expliqué succinctement la syntaxe de la phrase VA d´après les travaux de Pintzuk (1991).
Dans la Section 2.4, nous avons décrit plus précisement les caractéristiques propres aux verbes perfecto-présents : leur morphologie, et surtout leur syntaxe, notamment le complément qu´ils peuvent prendre. Un tel verbe se démarque de ses homologues forts et faibles, car un perfect-présent sélectionne un VP, et non un CP ou un TP, comme pour les autres verbes. Nous avons traité le verbe léger, tête de transitivité, v, soulignant ses caractéristiques, pour émettre notre hypothèse d´un vModal spécifique aux verbes perfecto- présents. Ces derniers diffèrent des verbes causatifs qui sont des V, et non des v, en VA.
Dans la Section 2.5, nous avons mis en évidence l´existence de deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents qui reflètent leur statut : verbe lexical, dans les constructions Perf.Pres + NP généré sous V, et verbe semi-lexical, dans les constructions Perf.Pres + VP (verbe de montée) généré sous vModal.
Dans la Section 2.6, nous avons abordé la négation et décrit la concordance négative et le critère Neg. Puis, nous avons analysé la particule adverbiale négative ne, laquelle est la tête d´une projection négative NegP. Nous avons montré qu´en VA, il existait deux projections NegP : une à la périphérie gauche de TP et l´autre à la périphérie gauche de vP. L´existence de ces deux projections illustrent, quand celles-ci apparaissent, la présence de la négation principale ne conjointement à l´adverbe négatif noht.
Dans la Section 2.7, nous avons repris l´analyse de Cinque (1999) concernant les adverbes et les têtes fonctionnelles. Notre analyse nous a permis de montrer qu´il existait en VA une hiérarchie (moins complexe) comparable à celle que propose Cinque pour l´AC. Nous proposons qu´aux différents types d´adverbes correspondent des têtes fonctionnelles particulières. Cette analyse nous permet de mettre en lumière l´existence de têtes pour le mode et la modalité.
Dans la Section 2.8, nous nous sommes intéressés au temps, au mode, à l´aspect perfectif et à la modalité, et nous avons reflété syntaxiquement leur présence en VA. Concernant la modalité, même si elle est moins marquée en VA, les exemples nous ont permis de voir que la grande majorité des perfecto-présents ont une lecture déontique, mais que dès la période tardive du VA, il existe quelques occurrences de perfecto-présents ayant une lecture épistémique. L´émergence de ces modaux coïnciderait avec l´emploi de en plus plus rare de l´aspect perfectif. De plus, nous avons souligné que les formes morphologiques passées pouvaient désormais avoir un sens irréel (et donc conditionnel). Ces deux faits de langue nous permettent de voir la grammaticalisation à la fin de cette période VA, qui, syntaxiquement, souligne le statut de verbes de montée des perfecto-présents épistémiques.
Tous ces différents points augurent des stabilisations et des changements que vont connaître les verbes perfecto-présents à la période moyen-anglaise, notamment les perfecto-présents déontiques.