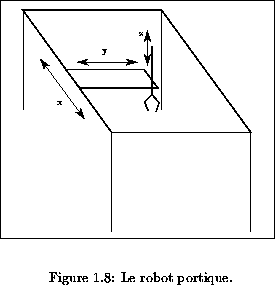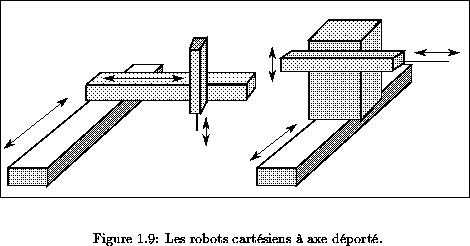Les robots cartésiens
On appelle robot cartésien
les robots dont le porteur assure des
déplacements de l'organe terminal selon les trois axes d'un repère
orthonormé (leur structure est donc de type PPP).
Si l'on suppose que les actionneurs ont une course de le volume de
l'espace de travail d'un robot cartésien est alors un cube de volume
.
Une telle conception assure bien sûr une simplicité de
commande pour certains déplacements car on n'a pas à effectuer de
transformations cinématiques.
Dans cette catégorie on va tout d'abord trouver les robots portique (figure 1.8). Ils sont
constitués d'une armature à 4 pieds sur lequelle se translate un chariot.
Sur ce chariot une table coulissante assure les translations selon l'axe
perpendiculaire au chariot. Un autre organe de translation assure les
déplacements selon l'axe vertical. Enfin un poignet permet de contrôler
les rotations.
Le robot portique offre les avantages suivants : grande rigidité, bonne précision (grâce au découplage partiel des axes), vitesse et accélération importantes ( grâce à la diminution de la masse mobile). De plus leur modèle dynamique est aisé à établir. Leur gros inconvénient est qu'ils ne sont adaptés principalement qu'au tâche dont l'axe principal est l'axe vertical avec un espace de travail relativement réduit par rapport à leur encombrement. Notons aussi que les axes X-Y d'un robot portique sont équilibrés.
Exemples de caractéristiques
Robot C148 de Renault Automation
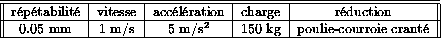
Un autre type de robot cartésien utilise des axes déportés. Dans ce type l'armature est remplacée par un rail de guidage unique. Un chariot se translate le long de l'axe avec une table assurant les déplacements soit selon l'axe vertical soit selon la direction perpendiculaire aux déplacements du chariot. Enfin un troisième organe de translation assure le déplacement manquant (figure 1.9).
Exemples de caractéristiques
Epson X2

Toshiba SR-L

Next: Les porteurs de Up: Principaux types de Previous: Principaux types de